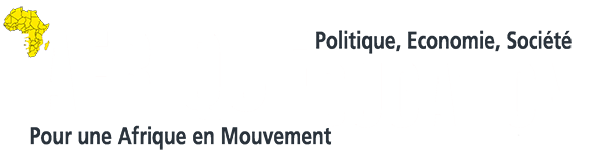X
LITTERATURE : “La Grève des bàttu” d’Aminata Sow Fall
Date
Il y a des romans qui vous tiennent en haleine jusqu’à la dernière ligne parce qu’ils mêlent avec bonheur humour et gravité. C’est le cas de “La Grève des Bàttu” publié en 1979 par la Sénégalaise, Aminata Sow Fall (notre photo), aux Nouvelles éditions africaines. « Bàttu » est un mot wolof qui signifie “calebasse’’ ou sébile. Au Sénégal et dans les autres pays où l’islam est la religion dominante, des hommes et des femmes utilisent la sébile pour mendier leur nourriture. Parmi ces mendiants, on trouve des lépreux, des estropiés, des aveugles, des manchots, mais aussi, les talibés dont l’âge varie entre 3 et 15 ans et qui sont confiés à des marabouts censés leur enseigner le coran. Où mendient-ils ? Un peu partout dans la ville (dans ce roman, on songe tout de suite à Dakar mais il pourrait bien s’agir de Kaolack, de Thiès ou de Louga), c’est-à-dire, devant les mosquées, aux carrefours, aux feux tricolores. Pourquoi mendient-ils ? Parce que c’est la seule façon pour eux de s’en sortir.
Dans le roman d’Aminata Sow Fall, les plus hautes autorités pensent que ces mendiants font honte au pays, donnent une mauvaise image de la ville aux touristes et qu’il est donc temps de la débarrasser de ces “déchets humains”. Pour elles, cet assainissement est d’autant plus nécessaire qu’un aveugle a blessé un jeune homme avec sa canne, il n’y a pas longtemps. La tâche est confiée à Mour N’Diaye, le directeur du service de salubrité qui aspire à occuper le poste de vice-président de la République. Rapidement, Mour contacte Kéba Daboye, son adjoint, qui envoie les mendiants à deux cents kilomètres de la ville.
Quelle sera la réaction de ces hommes et femmes jugés encombrants ? Se laisseront-ils faire ? Se borneront-ils à confier leur sort à Allah qui aime tous ses enfants ? Les mendiants se réunissent pour voir ensemble comment faire face. A l’unanimité, ils décident de faire grève, c’est-à-dire, de boycotter quiconque viendra leur faire l’aumône. Inutile d’ajouter que cette grève des bàttu, une grande première dans le pays, aura des conséquences non seulement pour les adeptes d’une religion dont le troisième pilier est la Zakât (partager avec les pauvres, donner aux démunis car les êtres humains ne possèdent rien qu’ils n’aient reçu d’Allah), mais également, pour ceux qui doivent faire des sacrifices pour obtenir une faveur ou une promotion sociale. Mour N’Diaye fait partie des gens qui veulent monter en grade. En visite chez le marabout, Serigne Birama, il apprend qu’il ne peut devenir vice-président de la République que s’il donne aux nécessiteux un gros mouton blanc découpé en plusieurs parts. Or, il n’y a plus un seul mendiant dans la ville. Cet obstacle est cependant vite surmonté car Mour sait où trouver les “déchets humains”. Il se rend donc à leur nouvel emplacement mais les mendiants, bien que confrontés à la misère, refusent son aumône. Ce refus pacifique mais ferme des mendiants, on peut le deviner, est synonyme de mort politique pour Mour. Il signifie que ce dernier ne pourra jamais réaliser son rêve. Avec ce niet, les mendiants prennent ainsi leur revanche sur celui qui les avait chassés sans ménagement de la ville et c’est cette revanche des petits, cette victoire des gens méprisés et rejetés hier, qui fait la beauté du roman d’Aminata Sow Fall. On a l’impression que, en aboutissant à un tel dénouement, la romancière sénégalaise a voulu discrètement rendre hommage à la dignité, à la solidarité et au courage des gens que les riches et puissants ont tendance à humilier au Sénégal et ailleurs en Afrique. Ce roman de 131 pages, qui obtint, en 1980, le Grand Prix littéraire d’Afrique noire, aurait donc pu s’intituler, aussi, “La revanche des exclus”. Une revanche qui, il faut le répéter, n’a été possible que parce que les mendiants se sont mis debout, se sont organisés et se sont mis ensemble pour se défendre au lieu de se résigner à leur triste sort.
“Celui qui combat peut perdre, mais, celui qui ne combat pas a déjà perdu”, disait le dramaturge allemand Bertolt Brecht. Il y a toujous moyen de sortir d’une situation d’oppression ou d’injustice car il n’y a pas de dictature qui écrase indéfiniment un peuple mais, pour qu’advienne le changement (la chute du dictateur), pour que demain soit meilleur qu’aujourd’hui, il faut que ceux qui sont opprimés acceptent de se lever et de combattre. Face au F CFA, une monnaie nazie qui profite plus à la France qu’aux Africains, face aux bases militaires françaises installées ici et là pour protéger les valets de la France, face aux tyrans incompétents et violents soutenus par Paris, je ne crois pas que nous soyons totalement dépourvus de moyens de pression et d’action et qu’il ne nous reste qu’à ronger notre frein dans nos cases et salons, abandonnant définitivement le terrain à l’ennemi. Nous devons plutôt comprendre que les tyrans “ne sont grands que parce que nous sommes à genoux” (Etienne de La Boétie) et que, pour dégager un homme qui “en opprime cent mille et les prive de leur liberté, il ne s’agit pas de lui ôter quelque chose, mais, de ne rien lui donner”. Ce que prône de La Boétie, en d’autres termes, c’est le refus de servir un pouvoir oppressif et injuste, c’est le “non” à la soumission volontaire à un régime peu respectueux des droits humains. Les mendiants, dans “La Grève des bàttu”, ont réussi à prendre leur revanche sur Mour N’Diaye parce qu’ils ont osé refuser ses dons.
Continuer à suivre les rebondissements d’un procès politique où 82 témoins à charge ont affirmé que les vrais criminels sont à Abidjan et à Paris et que les accusés n’ont fait que défendre leur pays, aller à La Haye ou manifester dans les rues de Paris ou de Bruxelles pour demander le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, tout cela me semble peu pertinent aujourd’hui. Ce qui serait plus utile et plus efficace, c’est de refuser de donner notre argent à Bolloré, à Bouygues, et aux autres entreprises françaises qui soutiennent Dramane Ouattara et font de grands bénéfices sur notre dos à travers l’eau, l’électricité, le téléphone, etc. Subtilement, la France est en train de nous déposséder. Lentement mais sûrement, elle est en train de nous déplacer du centre vers les marges de l’Histoire. Que faire pour arrêter tout cela ? Quelle posture devons-nous adopter pour montrer que le peuple a toujours eu le dernier mot ? Paralyser ou bloquer le pays et empêcher ainsi les parrains de Ouattara de continuer à voler nos richesses. Ce serait une façon de dire “non” comme les mendiants dans le beau roman d’Aminata Sow Fall, une manière de refuser de nous agenouiller devant des gens qui veulent nous voir vieillir et mourir dans la misère.
Jean-Claude DJEREKE
est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis).