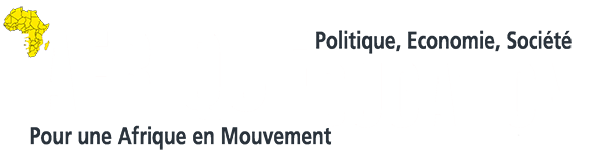X
COOPERATION : Pourquoi il ne faut pas avoir peur de la Russie
Date
Pour le moment, seuls deux pays africains, le Soudan du Nord et la République centrafricaine (RCA), ont signé des accords militaires avec la Russie de Poutine. Les autres pays africains, présents au premier Sommet Afrique-Russie de Sotchi, les 23 et 24 octobre 2019, devraient-ils leur emboîter le pas et établir un partenariat qui ne se limite pas au domaine militaire ? L’Afrique, en se tournant vers la Russie, ne se met-elle pas sous la domination d’une nouvelle puissance ? Que gagne-t-elle en nouant des relations avec la Russie ? Bref, qu’est-ce que Moscou donnerait aux Africains que Paris a été incapable de leur apporter en 6 décennies de pseudo-indépendance ? La meilleure façon de répondre à ces questions serait peut-être de montrer non seulement ce que la Russie a fait hier en Afrique et pour l’Afrique mais aussi comment elle voit les relations entre les pays aujourd’hui.
La Russie n’a pas de passé colonialiste. Elle n’a colonisé aucun pays en Afrique. Au contraire, elle fit adopter en 1960 une déclaration pour l’accession des peuples colonisés à l’indépendance. La France, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne s’étaient abstenus de voter cette déclaration. Avant cela, elle soutint des mouvements de libération tels que le Congrès national africain (ANC), le parti communiste sud-africain (SACP), le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), l’Union du peuple africain du Zimbabwe (ZAPU) de Joshua Nkomo et l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (SWAPO) du Namibien Sam Nujoma. Les Soviétiques aidèrent ces mouvements à se débarrasser du colonisateur (Cf. Alexandra Archangelskaya, “Le retour de Moscou en Afrique subsaharienne ? Entre héritage soviétique, multilatéralisme et activisme politique”, Afrique contemporaine, 2013, no. 248, pp. 61-74).
Nikita Khrouchtchev traitait d’égal à égal avec Kwame Nkrumah (Ghana), Modibo Keïta (Mali) et Ahmed Sékou Touré (Guinée). Chez lui, il n’y avait ni condescendance, ni arrogance comme on l’observe chez nos “ancêtres” les Gaulois dont le pays était considéré en 2013 par Pew Research Center, un think tank américain, comme le plus arrogant d’Europe.
Au plan culturel, au début des années soixante, l’Union soviétique envoya des professeurs dans l’enseignement technique et professionnel au Mali, au Ghana et en Guinée. Dans le dernier pays, elle construisit en 1962 l’Institut polytechnique de Conakry qui deviendra plus tard l’Université Gamal Abdel Nasser. Mais l’URSS ne se contenta pas d’aller former en Afrique. Elle accueillit aussi des étudiants africains sur son sol. Ainsi, environ 25 000 Africains furent formés dans les universités et collèges techniques soviétiques au milieu des années 1980. Une université soviétique portera même le nom de Patrice Lumumba assassiné le 17 janvier 1961. Je ne connais pas d’université française, belge, portugaise, espagnole ou anglaise baptisée du nom d’un homme politique africain. Même Senghor, qui fit beaucoup pour le rayonnement de la langue et de la culture françaises, ne bénéficia pas d’un tel honneur. Pire encore, le 29 décembre 2001, aucun officiel français ne prit part à la cérémonie d’inhumation du premier président du Sénégal à Dakar, peut-être parce qu’il ne donnait pas à Paris autant d’argent que son homologue ivoirien Félix Houphouët dont les obsèques avaient attiré toute la classe politique française à Yamoussoukro, le 7 février 1994.
En tant que membre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), la Russie soutient la réforme du Conseil de sécurité, afin que celui-ci soit plus représentatif.
Au plan diplomatique, la Fédération de Russie affirmait en 2013 que sa politique étrangère s’opposait à l’hégémonie et prônait la paix, le développement mutuel ainsi que la sécurité mondiale et régionale. Pour elle, les conflits internationaux doivent être résolus par un dialogue fondé sur la confiance et les avantages mutuels, l’égalité et la coopération. La politique étrangère de Poutine se fonde sur “la primauté du droit international, l’égalité et l’indépendance des États”. On comprend alors pourquoi il condamna “l’attitude agressive et intrusive” des pays occidentaux et pourquoi il compara l’intervention de l’OTAN en Libye en 2011 à “une croisade de l’époque médiévale [car, pour lui], la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU ne donnait pas le droit d’intervenir dans une affaire interne et de défendre un des deux camps” (Interview accordée au réalisateur américain Oliver Stone entre juin 2015 et février 2017). Je signale, au passage, que la Russie est intervenue en Syrie parce que Bacher al-Assad le lui avait demandé.
Contrairement à la France qui se croit obligée de déstabiliser ses anciennes colonies pour piller leurs richesses, la Russie possède d’immenses ressources naturelles. Plus de 20 % des stocks mondiaux lui sont attribués. Même si sa présence en Afrique n’est pas désintéressée, la Russie ne se montrera pas plus gourmande que la France.
La puissance militaire de la Russie est aujourd’hui indiscutable. En 2014, 2016 et en 2018, Vladimir Poutine a été déclaré l’homme fort de la planète par plusieurs magazines et journaux. Sans le soutien d’un allié aussi puissant que Poutine, il sera difficile, voire impossible, de nous débarrasser de ceux qui nous pourrissent la vie depuis 1960. La France s’immisce dans nos affaires, installe et dégage qui elle veut parce qu’il nous manque une force militaire égale ou supérieure à la sienne. Bachar al-Assad a bénéficié de cette force militaire de la part de la Russie, ce qui lui a permis de sauver sa peau et son fauteuil.
La Russie n’impose pas de conditionnalités en Afrique si l’on en croit Nina Bachkatov, journaliste, politologue et auteure de “Poutine, l’homme que l’Occident aime haïr” (Jourdan, 2018). Les pays de l’Europe occidentale, eux, aiment lier leur pseudo-aide économique et financière à la démocratie et au respect des droits de l’homme. Souvenons-nous de François Mitterrand au Sommet franco-africain de La Baule, le 20 juin 1990, 3 mois après les violentes manifestations contre le parti unique en Afrique. En effet, le Bénin organisa la première Conférence nationale en février 1990. En mars et avril 1990, syndicats, opposants et étudiants étaient dans la rue en Côte d’Ivoire, au Gabon et au Zaïre pour réclamer le multipartisme. Ce n’est donc pas Mitterrand qui bouscula les régimes autoritaires en Afrique. Le président socialiste essaya plutôt d’accompagner le mouvement de contestation qui avait commencé avant le discours de La Baule : “Il ne peut y avoir de démocratie sans développement et, inversement, de développement sans démocratie.” Mais Mitterrand voulait-il vraiment que l’Afrique se démocratise ? On est tenté de répondre par la négative parce qu’au 4e Sommet de la Francophonie de Chaillot (19 novembre 1991), Mitterrand recommandera que chaque pays aille à la démocratie à son rythme et à sa manière, ce qui ressemblait ni plus ni moins à un rétropédalage. Bref, il est difficile de ne pas penser que, pour la France et les autres pays occidentaux, la démocratie et les droits de l’homme ne sont bons que pour l’homme blanc, sinon pourquoi ces pays ne lèvent-ils pas le petit doigt lorsque leurs valets piétinent les droits de l’homme, pourquoi eux-mêmes foulent aux pieds les décisions du Conseil constitutionnel en Afrique, pourquoi ils laissent les dictateurs modifier tranquillement les constitutions ou bourrer les urnes pour s’éterniser au pouvoir (Denis Sassou Nguesso depuis 1979, Paul Biya depuis 1982, Idriss Deby depuis 1990) ?
D’ailleurs, qui a dit que c’est forcément la démocratie occidentale qui nous apportera le développement ? La Chine et la Russie, qui ne l’ont pas adoptée, sont-elles pour autant à la traîne et malheureuses ? Il est grand temps que les Africains posent un regard critique sur cette fameuse démocratie et évaluent sans complaisance ses avantages et inconvénients depuis qu’elle est apparue sur le continent. Je dis cela car quiconque regarde les choses de très près se rendra compte que la démocratie occidentale a été vidée de sa substance par ceux-là même qui veulent nous faire croire qu’il n’y a pas de salut en dehors d’elle, qu’elle n’est plus “le pouvoir de la collectivité”, que le peuple (le demos) a perdu un contrôle effectif sur son existence, qu’il a basculé dans l’hétéronomie. Or, pour Cornelius Castoriadis, au cœur de la démocratie, il y a l’autonomie. Le penseur français d’origine grecque insiste sur le fait que la démocratie grecque signifiait que “le peuple se proclame souverain et crée des institutions permettant la réalisation effective de cette volonté de souveraineté”. Voilà pourquoi la démocratie athénienne refusait à la fois la représentation et l’expertise politique (il ne peut y avoir de spécialistes de la totalité). Je suis d’accord avec Castoriadis quand il soutient que la démocratie ne se limite pas à déposer son bulletin dans l’urne ou à jouir de la liberté de parole mais qu’elle doit être “le lieu d’une réelle participation de tous à la vie et au devenir de la société [afin que] les individus soient maîtres de leur vie, de leur société, des institutions qu’ils se donnent” (C. Castoriadis, “Quelle démocratie ?”, tomes 1 et 2, Paris, Sandre, 2013).
C’est un secret de Polichinelle que l’homme fort de Moscou est haï, dénigré et combattu par ceux qui n’ont jamais voulu notre bien. Ils lui en veulent, entre autres, parce qu’il a soutenu militairement le président syrien contre les rebelles et djihadistes de Daesh qui aurait été créée par Barack Obama et Hillary Clinton selon une révélation faite par Donald Trump pendant la campagne électorale de 2016. Ce Poutine, qui a montré de quoi il était capable en Ukraine et en Syrie, je souhaite qu’il devienne l’allié des pays africains.
A la différence de la France qui refusa en 2002 d’aider la Côte d’Ivoire à mater la rébellion venue du Burkina Faso malgré les accords de défense signés par les deux pays en 1961, la Russie n’a pas abandonné le président syrien en pleine tempête. Elle lui apporta un soutien sans faille parce que Bachar al-Assad avait montré, entre autres qualités, qu’il était un homme sérieux et digne de confiance. Staline (notre photo), le prédécesseur de Khrouchtchev, jugeait les leaders africains “peu fiables, prêts à la trahison et prêts à conclure des accords à l’amiable avec les impérialistes contre lesquels ils ne prétendaient lutter que verbalement” (Vladimir Bartenev, “ L’URSS et l’Afrique noire sous Khrouchtchev : la mise à jour des mythes de la coopération”, Outre-Mers. Revue d’histoire, 2007, Nos. 354-355, pp. 63-82).
La Russie est capable de tenir les promesses qu’elle fera à l’Afrique parce qu’elle a déjà prouvé en Syrie que la parole donnée est un engagement à respecter, mais, les Africains respecteront-ils leurs engagements ?
Jean-Claude DJEREKE
est professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)