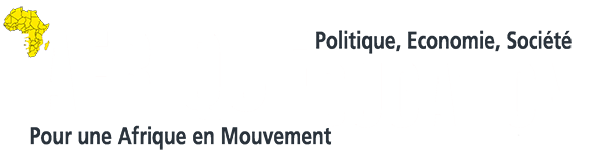X
AFRIQUE : La trahison des “intellectuels” africains
Date
Quand Diouldé retourne au pays, après plusieurs années ? en Hongrie, il n’est pas seulement nanti d’un diplôme en électricité. Il a aussi quelques idées qui, pense-t-il, peuvent contribuer à la transformation de son pays. Une fois sur le terrain, il constate cependant qu’il est impossible de s’exprimer et d’agir librement (le dictateur Sâ Matraq, qui a fait construire un camp de concentration, règne par la terreur et la répression), que le pays est miné par la corruption, le népotisme, le clientélisme et l’opportunisme et que certaines personnes ayant achevé des études secondaires ou supérieures participent à la destruction du pays. Au début, Diouldé essaie d’être irréprochable, de bien accomplir sa tâche, bref, de vivre en conformité avec ses principes mais, dans un environnement où l’honnêteté est de plus en plus perçue comme un délit, il finit par faire comme tout le monde, c’est-à-dire, ne pas arriver à l’heure au travail, détourner les deniers publics, accumuler villas, voitures, femmes et argent, rançonner le petit peuple, etc. C’est ici que se dévoile la signification du titre du roman : “Les crapauds-brousse”. Pourquoi l’auteur a-t-il choisi ce titre ? Alors que la légende peule (l’ethnie de Tierno Monénembo) considère le crapaud comme un être parfait, Diouldé, Gnawoulata (riche trafiquant), Daouda (exerçant dans la police politique) et d’autres personnages brillent par leur laideur morale. En effet, bien qu’ils soient prompts à critiquer le régime dictatorial de Sâ Matraq, ils ne se privent jamais de “boire comme des fous, manger comme des vicieux de l’appétit, dévoués au festin comme s’il n’y avait plus que cela”. Bref, la seule chose qui semble intéresser Diouldé et ses compagnons, c’est une vie de divertissement (au sens pascalien du terme) et de futilité. On comprend dès lors pourquoi Josiane (un autre personnage du roman) ne se montre guère tendre à leur égard en affirmant : “Eux qui auraient dû être la Solution, ils ne l’étaient en rien. C’était plutôt eux, le Problème, à la lumière de la vérité.” Josiane ne comprend pas qu’eux, qui “étaient nés dans cet océan de belle misère, dans ces merveilleuses contrées d’enfants meurtris, mais, encore vierges et promis à la Grande Œuvre du Futur”, ne soient que “des fêtards insouciants”.
Pour moi, le principal message de l’auteur à l’Afrique se trouve dans ces paroles de Josiane : ce n’est pas en dansant et en buvant indéfiniment que nous changerons la situation de l’Afrique. Exceptés le Nigérian Wole Soyinka (qui séjourna plusieurs fois en prison pour avoir fustigé les différents despotes de son pays), le Camerounais Mongo Beti (notre photo) (qui ne ménagea ni Amadou Ahidjo ni Paul Biya coupables à ses yeux d’avoir vendu le Cameroun à la France), le Kenyan N’Gugi Wa Thiongo (que Daniel Arap Moi jeta en prison à cause de ses écrits jugés subversifs) et d’autres figures iconoclastes, ceux qu’on appelle intellectuels (un abus de langage, selon moi) semblent être le problème N°1 de l’Afrique dans la mesure où ils se sont compromis et prostitués avec des régimes violents et incompétents, dans la mesure où ils sont plus soucieux de leur petit confort que de l’amélioraton des conditions de vie et de travail du petit peuple, dans la mesure où leur seule obsession est de ressembler et de plaire à leurs maîtres occidentaux.
En un mot, si l’Afrique est en faillite, si elle tourne en rond depuis cinq décennies, c’est d’abord et avant tout, parce que ceux qui étaient censés la protéger et la défendre contre les prédateurs extérieurs ont failli à leur mission, parce que ces derniers ont trahi les espoirs que leurs peuples avaient placés en eux. Sur ce point, je suis parfaitement en accord avec Tierno Monénembo. Nous divergeons par contre sur le mot “intellectuel”. Je n’appellerais pas n’importe qui “intellectuel”, je fais le distinguo entre intellectuel et diplômé, car un intellectuel n’est pas qu’un “penseur de métier”. Ce qu’on attend aussi de lui, c’est qu’il “avertisse, dénonce ce qui ne va pas dans la société” ou qu’il “soit retourné devant l’injustice et l’oppression” (Paul Nizan dans “Les chiens de garde”, Marseille, Agone, 1998). Dans “Les crapauds-brousse”, pourquoi Diouldé et les autres se taisent-ils alors qu’il y a tant de choses qui pourraient susciter leur colère et révolte ? Parce qu’ils ont peur d’être arrêtés et incarcérés, parce qu’ils ne veulent pas risquer leur vie ni celle de leurs proches, parce qu’ils n’ont pas envie de provoquer l’ire du dictateur. Or, écrit Edward Wadie Said, “l’intellectuel, au sens où je l’entends, n’est ni un pacificateur ni un bâtisseur de consensus, mais, quelqu’un qui engage et qui risque tout son être sur la base d’un sens constamment critique, quelqu’un qui refuse, quel qu’en soit le prix, les formules faciles, les idées toutes faites, les confirmations complaisantes des propos et des actions des gens de pouvoir et autres esprits conventionnels. Non pas seulement qui, passivement, les refuse, mais qui, activement, s’engage à le dire en public.” Il ajoute : “Le choix majeur auquel l’intellectuel est confronté est le suivant : soit s’allier à la stabilité des vainqueurs et des dominateurs, soit – et c’est le chemin le plus difficile – considérer cette stabilité comme alarmante, une situation qui menace les faibles et les perdants de totale extinction, et prendre en compte l’expérience de leur subordination, ainsi que, le souvenir des voix et personnes oubliées.” (Edward W. Said, “Des intellectuels et du pouvoir”, Seuil, Paris, 1996).
C’est cette solidarité de l’intellectuel avec la collectivité qui conduit naturellement le sociologue Pierre Bourdieu à parler de “l’intellectuel collectif”. Celui-ci, explique-t-il, “peut et doit remplir d’abord des fonctions négatives, critiques, en travaillant à produire et à disséminer des instruments de défense contre la domination symbolique qui s’arme aujourd’hui, le plus souvent, de l’autorité de la science”. Pour Bourdieu, un intellectuel digne de ce nom ne peut “se réfugier dans le petit monde académique, où [il] s’enchante [lui]-même de [lui]-même, sans être en mesure d’inquiéter qui que ce soit en quoi que ce soit” (P. Bourdieu, “Contre-Feux 2, Raisons d’agir”, Paris, 2001).
Paru en 1979 chez Seuil, le roman “Les crapauds-brousse” joue ainsi dans le même registre que “La Vie et demie” de Sony Labou Tansi ou “Les Soleils des indépendances” d’Ahmadou Kourouma en ce qu’il est critique vis-à-vis de la gouvernance des Africains après le départ du colon. Certains lecteurs n’ont pas tardé à identifier Sâ Matraq à Sékou Touré. Il est vrai que l’homme du “non” à de Gaulle mena la vie dure à ses opposants mais la dictature ne sévissait-elle qu’en Guinée à cette époque ? Et puis, la Côte d’Ivoire, le Congo-Brazzaville ou le Cameroun d’aujourd’hui sont-ils différents de la Guinée d’alors ?
Jean-Claude DJEREKE
Professeur à Temple University
(Philadelphie) USA