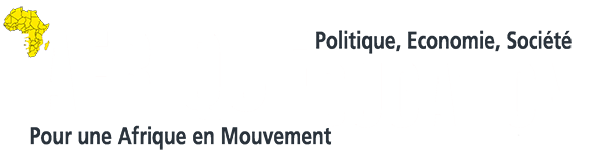X
COTE D’IVOIRE : Séry Bailly, le pontife, s’en est allé

Date
L’un des titres portés par le pape est « le souverain pontife ». Pontife vient de deux mots latins : pons, pontis = pont et facere = faire, construire. Le « pontifex » est celui qui fait ou construit des ponts. Séry Bailly était à sa façon un pontife parce qu’il était un jeteur de ponts entre les générations, parce qu’il voulait que les jeunes sachent ce que les aînés avaient écrit/fait et inversement.
L’ouvrage « Porteurs d’espoirs » (L’Harmattan, 2013) a ainsi pour but de porter, à la connaissance de ceux qui sont nés dans les années 60, 70 et 80, le parcours et les combats des Christophe Wondji, Harris Memel-Fotê, Christophe Dailly, Barthélemy Kotchy, Georges Niangoran-Bouah, Laurent Aké-Assi, Benié Tanoh ou Coulibaly Yédiety.
En acceptant de préfacer les ouvrages de quelques jeunes auteurs, il souhaitait probablement envoyer aux anciens le message suivant : « Lisez vos petits frères et vous saurez comment ils voient le monde, la Côte d’Ivoire, les hommes et femmes politiques du pays, etc. Ça vaut vraiment la peine de connaître leurs rêves, passions, indignations et colères ». Bailly désirait ardemment que ces deux univers, le monde des Charles Nokan et celui des Macaire Etty, se découvrent, se rencontrent et se parlent car, pour lui, seule la rencontre peut permettre aux humains de se débarrasser des « préjugés [qui] ont toujours la peau dure [et] influencent les jugements qu’on porte sur les autres, quelle que soit leur performance ». Il ne parlait ni d’être ensemble ni de vivre ensemble, peut-être parce que le second concept cher au Rassemblement des républicains était devenu autre chose (vivre chez les autres sans eux) que ce qu’il devrait être dans notre pays. Au « vivre ensemble », Séry préférait le « faire chemin ensemble ».
Le 12 janvier 2010, la République d’Haïti fut dévastée par un tremblement de terre. De nombreux cadres et hauts cadres perdirent la vie dans cette tragédie. Pour Séry Bailly, il était hors de question que les Africains abandonnent ce pays meurtri à son triste sort. Il préconisait que l’Afrique subsaharienne fasse chemin avec les Haïtiens, qu’elle les aide à panser leurs blessures, bref qu’elle leur apporte l’aide dont peut avoir besoin un pays qui vient d’être frappé par un violent séisme parce que Haïti est une partie de nous-mêmes tout comme la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, parce que « nous sommes fils du même village ». C’est le message central de l’ouvrage « Paroles de Côte d’Ivoire pour Haïti. Notre devoir de solidarité » (Ceda/Nei). Le message est toujours d’actualité car le pays souffre cruellement d’un manque d’enseignants et de médecins. Cela montre que Bailly n’était pas replié sur son pays, mais qu’il pouvait voir loin et grand. Indiscutablement, il y avait du Camus chez lui car, comme l’auteur de « La Peste », il était révolté par la souffrance, la mort, les injustices qu’il ne se contenta pas d’expliquer car le plus important et le plus utile, à ses yeux, était le combat contre le mal sous toutes ses formes. Combattre par la solidarité et le partage.
Il était bien conscient que le « faire chemin ensemble » devait commencer dans son propre pays. C’est tout le sens de l’expression « ne pas perdre le Nord » dans l’essai qui porte le même titre et fut publié par Educi en 2005. L’expression est à la fois une prise de position contre la partition du pays et une invitation à savoir raison garder. Même si la cause qu’on défend est juste, on doit demeurer raisonnable, c’est-à-dire, qu’on doit se garder de faire sécession, de quitter la famille avec une partie du pays, estimait-il.
Séry Bailly n’a eu de cesse de cheminer avec la tradition pour en recueillir le meilleur. Il s’intéressait à ses proverbes, contes et légendes parmi lesquels, « Le mythe de Babo Naki », ouvrage du poète, Josué Guébo, dont il rédigea la préface. De ce mythe, il tira la leçon que la Côte d’Ivoire avait besoin de la contribution de tous ses enfants pour renaître. Lui qui était ouvert à la tradition, la philosophie et le langage des adeptes du Zouglou et du Nouchi n’avaient cependant pas de secret pour lui.
Il savait aussi cheminer avec les mots. On lui doit, dans ce registre, des formules heureuses et croustillantes comme « les décideurs doivent avoir en face d’eux des gens décidés », « ils [les jeunes patriotes] n’habitent pas la rue, la rue les habite », ou encore, « ce n’est pas parce que vous avez raison qu’on vous donnera raison ». Cette dernière formule se trouve dans sa préface à mon essai « L’Afrique et le défi de la seconde indépendance » paru chez L’Harmattan en 2010.
Cet homme, qui savait produire de belles choses avec les mots et les images, était-il pour autant coupé des choses de la Cité ? Comment s’est-il comporté pendant la guerre de la France contre la Côte d’Ivoire ? Quel rôle assignait-il aux littéraires ? Les médias français dont les propriétaires ont des atomes crochus avec le gouvernement, pensaient qu’il suffisait de moquer les jeunes patriotes et de les qualifier de désœuvrés pour discréditer leur résistance et leur lutte pour une Côte d’Ivoire libre et souveraine. Bailly, lui, parlait de jeunes qui ont « bravé le feu et les plombs de l’adversaire » (S. Bailly, « La résistance patriotique des jeunes et installations dans la rue » in Les Cahiers du Nouvel esprit, 1er avril 2006, p. 41). Si « s’engager, c’est quitter l’état de spectateur pour rejoindre celui d’acteur » (Lionel Jospin, le 2 février 2000 à l’Université de Louvain après la réception du titre de docteur honoris causa), on peut affirmer que Séry Bailly n’était pas partisan de « l’art pour l’art » mais qu’il était un écrivain et un penseur engagé.
Aujourd’hui encore, il se trouve des gens qui prétendent que seuls les scientifiques sont engagés dans la transformation du monde et qu’eux seuls font avancer une société. Pour eux, philosophes, sociologues, psychologues, historiens, linguistes, etc. sont aussi inutiles qu’inefficaces. Voici la réponse de Bailly aux auteurs de ces prétentions ridicules : « Le littéraire pose la question de l’utilité à quoi ou à quelle fin ? … A force d’être dans l’utilitarisme, on est dans une soumission aveugle au principe du profit et c’est en vain qu’on parle de bonne gouvernance. Pour atteindre la destination sans voyage, on n’a pas besoin de gouvernail. L’homme de lettres travaille à l’avènement d’une société de solidarité afin que dans le partage, chacun puisse mener une vie de dignité. Le littéraire donne mauvaise conscience à ceux qui sont rassasiés seuls et jettent même leurs surplus ». Pour Séry Bailly, il ne s’agit donc pas de mettre les sciences au-dessus des arts mais de considérer que les deux sont complémentaires et que « la science satisfait les besoins tandis que d’autres, notamment, la littérature en particulier et les arts en général, doivent prendre en charge le désir qui représente la dimension de l’aventure et de la liberté [car] l’homme est plus que son estomac. » (cf. https://www.fratmat.info/index.php/sports/pr-sery-bailly-le-litteraire-d…).
Bailly pensait que les Africains francophones et anglophones devraient faire chemin ensemble pour la simple raison qu’ils font partie d’une seule et même famille. Il ne comprenait pas que des peuples, qui partagent la même histoire marquée par l’esclavage, la colonisation et le néo-colonialisme, se laissent diviser par les langues du colonisateur. Pour démontrer que les Africains sont fils et filles de la même mère et que leur histoire commune compte plus que la langue dans laquelle ils s’expriment, il choisit, pour sa thèse de doctorat, de travailler sur « Le désenchantement dans les romans des écrivains africains anglophones de la deuxième génération (A. K. Armah, K. Awoonor, W.T. Ngugi, W. Soyinka) ». J’avais déjà lu et aimé « Enfant, ne pleure pas » du Kenyan James Ngugi et « Les Tribulations de frère Jéro » du Nigérian Wole Soyinka mais c’est Séry Bailly qui me fera entrer dans la pensée du Ghanéen Ayi Kwei Armah à travers son livre culte « L’âge d’or n’est pas pour demain » (The beautiful ones are not yet born). C’était dans le cadre du Certificat d’études africaines que nous devions décrocher en même temps que la licence ès Lettres Modernes à la fin de l’année académique 1986-1987.
C’est en 2011, soit, 24 ans plus tard, que nous nous revîmes. A l’époque, j’enseignais les techniques d’expression écrite et orale à l’ENA et je donnais un coup de main au prof. Amoa Urbain comme vice-recteur de l’Université Charles-Louis Montesquieu. J’avais appelé le prof. Séry Bailly pour le saluer et lui, spontanément, se proposa de venir me chercher à la Rue des Jardins de Cocody pour un déjeuner chez lui à La Riviera-Les Rosiers. Ce déjeuner n’était qu’un prétexte car lui et moi avions en réalité envie d’échanger sur cette Côte d’Ivoire où la tension était extrêmement vive, la « République du Golf » ne reconnaissant pas le président de la vraie République. Au cours du repas, il évoqua notre affrontement de 2006 dans les colonnes de « Le Courrier d’Abidjan ». Cette année-là, en effet, j’avais rompu des lances avec lui. Pourquoi ? J’avais exprimé mon étonnement devant le fait que des enfants issus de familles pauvres étaient obligés de débourser 1 à 2 millions de F CFA pour entrer à l’ENA. Cela me semblait non seulement contraire aux valeurs de la gauche mais contradictoire avec le « gouverner la Côte d’Ivoire autrement » prôné par le FPI quand il était dans l’opposition. Mon étonnement ayant été mal accueilli par le prof. Séry Bailly, je dus produire une autre tribune pour défendre mon point de vue. Bailly revint sur cette disputatio mais pour admettre que c’est moi qui avais vu juste et que c’est pour cette raison qu’il ne donna pas de réplique à ma tribune. Cette humilité, touchante et désarmante, est incontestablement le propre des grands hommes.
Un grand homme, un pontife, un bâtisseur de ponts, s’en est allé. Par-delà les ponts qu’il s’attela à jeter entre les générations, entre la tradition et la modernité, entre le discours et l’engagement, Bailly aura surtout travaillé pour que ses compatriotes prennent conscience de ce qui se passe autour d’eux et des dangers qui les guettent. Ce travail est immense et inestimable car « un individu conscient, éveillé et debout est plus dangereux pour le pouvoir en place que 10.000 individus endormis et apeurés » (Gandhi).
Jean-Claude DJEREKE
Professeur de littérature à l’Université de Temple (Etats-Unis)