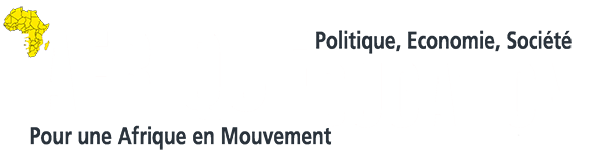X
BELGIQUE : Des métisses demandent réparation à l’Etat pour son passé colonial

Date
Arrachées à leurs mères noires au Congo pendant la période coloniale, cinq femmes réclament à l’Etat belge des indemnisations, invoquant les précédents canadien et australien.
La Belgique fait face à son histoire coloniale. Cinq femmes métisses arrachées à leurs mères noires au Congo, il y a environ 70 ans, exigent à partir de ce jeudi, 14 octobre, des réparations à l’Etat belge, accusé devant le tribunal de Bruxelles de «crimes contre l’humanité» pour des faits commis sous l’ère coloniale.
A l’âge de deux, trois ou quatre ans, ces femmes, qui sont, aujourd’hui, grands-mères, ont été retirées de force à leur famille maternelle, puis, placées dans une institution religieuse située «parfois à des centaines de kilomètres», a expliqué Me Michèle Hirsch, avocate de Léa, Monique, Simone, Noëlle et Marie-Josée, toutes nées de l’union entre une mère congolaise et un homme blanc, présentes à l’audience entourées de proches (notre photo).
«Je les appelle par leur prénom, car leur identité leur a été enlevée. Elles ont été sans voix pendant près de 70 ans, incapables de raconter», a lancé l’avocate. «Durant la colonisation, le métis était considéré comme une menace pour la suprématie de la race blanche, il fallait l’écarter», a relaté Me Hirsch, parlant d’un «système généralisé» mis en place par l’Etat belge.
Un procès historique
Les avocats de l’Etat devaient, ensuite, prendre la parole. Ils contestent les faits et la qualification retenue par les plaignantes. Les «crimes contre l’humanité» sont imprescriptibles en droit belge, comme les crimes de génocide et crimes de guerre. Ce procès est le premier en Belgique à mettre en lumière le sort réservé aux métis nés dans les anciennes colonies belges (Congo, Rwanda, Burundi), jamais, officiellement, recensés mais dont le nombre est généralement estimé autour de 15.000. La plupart des enfants nés de l’union entre une femme noire et un homme blanc n’étaient pas reconnus par leur père, et ne devaient se mêler ni aux blancs, ni aux Africains. Conséquence pour beaucoup : la mise sous tutelle de l’Etat et le placement en orphelinat moyennant le versement de subventions à ces institutions, généralement, gérées par l’église catholique.
«A l’école, on nous traitait de “café au lait”. Nous n’étions pas acceptés», s’est souvenue une des plaignantes, Simone Ngalula. «On nous appelait “les enfants du péché”. Un Blanc ne pouvait pas épouser une Noire. L’enfant né de cette union était un enfant de la prostitution», a raconté Léa Tavares Mujinga, née d’un père portugais et enlevée à l’âge de 2 ans dans les années 1940.
«Les excuses, c’est facile, mais quand on pose un acte il faut l’assumer»
Aux yeux des plaignantes, les excuses formulées en 2019 au nom de l’Etat par le premier ministre belge doivent être suivies de réparations. Charles Michel, désormais, président du Conseil européen, avait alors reconnu «une ségrégation ciblée», et déploré des «pertes d’identité» avec la séparation des fratries, y compris au moment des rapatriements en Belgique après l’indépendance du Congo en 1960. «On nous a détruites. Les excuses, c’est facile, mais quand on pose un acte il faut l’assumer», a soutenu Monique Bitu Bingi, lors d’une conférence de presse avec les quatre autres plaignantes avant le procès.

Elle a dénoncé «un deuxième abandon», lorsque après l’indépendance, ces fillettes n’ont pas pu monter dans les camions de l’ONU pour être rapatriées avec les Occidentaux. L’autorité du nouveau pouvoir congolais était contestée, des heurts ont éclaté, certaines disent avoir été victimes d’abus sexuels de la part des rebelles. Toutes réclament, aujourd’hui, à la justice belge «une somme provisionnelle de 50.000 euros» et la nomination d’un expert pour évaluer leur préjudice moral. Jeudi, 14 octobre, les plaidoiries devant le tribunal civil de Bruxelles ne devaient pas excéder trois ou quatre heures. Le jugement sera mis en délibéré et ne devrait pas être rendu avant plusieurs semaines. Michèle Hirsch défend les plaignantes au côté de Christophe Marchand, avocat de la famille de l’ex-premier ministre congolais assassiné, Patrice Lumumba, dans une autre procédure encore en cours à Bruxelles.
Les précédents australien et canadien
Ils citent en exemple les dédommagements promis par les autorités canadienne et australienne pour réparer le placement forcé, pendant des décennies, des enfants autochtones dans des pensionnats ou des familles blanches. En août dernier, l’Australie avait annoncé un grand plan de près d’un milliard de dollars australiens (620 millions d’euros) pour tenter de combler le fossé qui existe entre la population d’origine indigène et le reste des citoyens d’ici 2031. La mesure phare résidait dans la promesse de verser une indemnisation de 75.000 dollars (46.000 euros) à ceux que l’on nomme la «génération volée». Il s’agit des enfants d’Aborigènes australiens et d’Indigènes du Détroit de Torrès enlevés de force à leurs parents entre 1910 et 1970 pour être placés dans des familles d’accueil blanches. Au total, 378,6 millions de dollars seront alloués à ces indemnisations. Après les excuses, il s’agit de passer des «paroles» aux «actes», avait dit en substance le premier ministre, Scott Morrison, décrivant ces politiques officielles d’assimilation comme une période «honteuse» de l’histoire du pays.

En 2007, le Canada avait entamé une démarche similaire en approuvant un processus d’évaluation indépendant, né d’un règlement global de plusieurs actions collectives. Le but : réparer les torts infligés à des générations d’enfants autochtones, envoyés dans des pensionnats spécialisés créés dans les années 1820. Environ, 150.000 enfants des Premières Nations ainsi que des enfants inuits ou métis y avaient été emmenés pour faire «sortir l’Indien de l’enfant». En mars 2021, un rapport faisait état de 38.276 réclamations et de 3,23 milliards d’indemnisations attribuées.
Fin septembre dernier, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau avait été débouté par la Cour fédérale alors qu’il demandait une révision des conditions d’indemnisations.