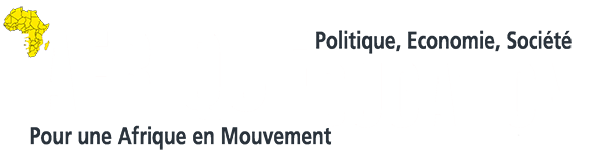X
CAMEROUN : Hommage à Mongo Beti mort le 8 octobre 2001

Date
C’était un 8 octobre et c’était en 2001. Les portes du nouveau millénaire venaient juste de s’ouvrir. Il y a donc 15 ans que tu fermais les yeux et que tu quittais ce monde (une mort bête, pourrait-on dire, car le groupe électrogène de l’hôpital de Yaoundé, où tu t’étais rendu pour une dialyse, tomba en panne et arriva ce qui devait arriver en pareille circonstance), un monde qui te semblait dur, injuste et cruel pour les pauvres et les petits comme Banda spolié de son cacao, fruit de plusieurs mois de labeur, par un contrôleur menteur et malhonnête. Il était venu à Tanga, ce Banda, dans l’espoir que l’argent de son cacao lui permettrait de payer la dot de sa fiancée. Deux quartiers cohabitaient dans cette ville sans se rencontrer, sans se parler : d’un côté, le Tanga Sud, quartier des colons, de l’administration et des centres commerciaux ; de l’autre, le Tanga Nord où les Noirs côtoyaient quotidiennement les immondices, la misère, la maladie et la faim. Mais Tanga, dont tu fis une saisissante description dans ton premier roman, n’était rien d’autre que Mbalmayo, le chef-lieu du village qui te vit naître le 30 juin 1932. Un jour de novembre 1982, alors que je passais par là, quelqu’un me révéla que c’était le Tanga dont il était question dans Ville cruelle. J’étais à la fois heureux et ému de découvrir enfin ce fameux Tanga. Je repensai alors aux frustrations du jeune Banda, à la colère qui montait en lui quand il entendit la maudite phrase : “Mauvais cacao!” Je pensai surtout au courage dont il fit preuve par la suite en disant aux cinq femmes qui l’avaient accompagné que le contrôleur grec n’était pas un homme mais une bête. De ce roman, qu’Alexandre Biyidi (notre photo) écrivit à 22 ans, je retirai la leçon suivante : un homme digne de ce nom n’a pas le droit de se résigner à l’injustice ; il doit toujours rester debout face à l’oppresseur. Sitôt sortis de prison, certains des nôtres ont couru chez le Blanc qui avait bombardé leur pays pour lui faire allégeance avec, dans la bouche, le fallacieux argument qu’il est trop fort, qu’on ne peut rien contre lui, que c’est lui qui met les Nègres au pouvoir en Afrique et qu’on a donc intérêt à discuter avec lui ou avec ses valets. Toi, tu enseignes, dans Ville cruelle, qu’un homme ne doit jamais courber l’échine, quels que soient les revers et épreuves de la vie. Tu voulais que chacun de nous agisse comme Banda car, si le Blanc méprise royalement les béni-oui-oui, il respecte en revanche ceux qui lui tiennent tête. Mais combien d’entre nous ont retenu l’enseignement? Combien sont persuadés aujourd’hui que “s’aplatir ou se soumettre, sous prétexte que la soumission peut adoucir les cœurs de ceux qui sont en face de nous, n’a jamais payé dans le monde” (Laurent Gbagbo en 2010) ? Parfois, certaines expériences de la vie nous font percevoir mieux la justesse de telle ou telle affirmation. De leur vivant, en effet, Senghor et Césaire étaient regardés et traités différemment par l’ancien colonisateur. L’un était adulé, l’autre ignoré, haï et voué aux gémonies, simplement, pour avoir écrit que la colonisation n’était pas civilisation mais chosification du Noir et exploitation des richesses de son sous-sol (cf. Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, 1956). Mais, que vit-on quand ces fondateurs de la Négritude décédèrent ? Ni Jacques Chirac ni Lionel Jospin ne firent le voyage de Dakar pour assister aux obsèques du Sénégalais qui avait pourtant tout donné pour le rayonnement de la France. Quant au Martiniquais, qui ne céda jamais à la tentation de caresser la France dans le sens du poil, plusieurs personnalités politiques françaises souhaitaient qu’il fût inhumé au Panthéon comme Voltaire, Zola ou Victor Hugo. La suite est connue : les Martiniquais, qui se souvenaient que Césaire avait toujours préféré “l’honneur aux honneurs et vanités de ce bas monde” (Pyepimanla), opposèrent un refus poli mais ferme à cette reconnaissance tardive et opportuniste.
Bref, Ville cruelle m’initia à la révolte et à la lutte contre l’injustice tout en me donnant l’envie de lire tes autres ouvrages : Mission terminée, Le roi miraculé, Perpétue et l’habitude du malheur, La France contre l’Afrique, Main basse sur le Cameroun. Autopsie d’une décolonisation (essai qui sera censuré en France sous la pression d’Ahidjo, l’homme que la France jugeait plus accommodant que les leaders nationalistes de l’Union des populations du Cameroun). Inutile de te dire que j’ai aimé ces chefs d’œuvre écrits dans un style mordant et percutant. Mais c’est Le Pauvre Christ de Bomba, publié quatre ans avant les indépendances nominales de 1960, qui me toucha et me captiva le plus. Pourquoi ? Parce que je trouve les questions soulevées dans ce roman étrangement d’actualité. Je les formulerai de la manière suivante : 1) Débarrassé de la faim et de l’ignorance, l’homme peut-il continuer à adorer Dieu ? 2) Pourquoi les Africains ont-ils embrassé le christianisme ? Chacun de nous se rappelle la réponse de Jésus à la foule qui le cherchait après la multiplication des pains : “Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que je vous ai donné du pain à manger et que vous avez été rassasiés” (Jn 6, 26). Le Christ de Bomba, le RPS Drumont, mit du temps avant de réaliser pourquoi les Tala avaient demandé et reçu le baptême et d’autres sacrements. Il croyait que ces derniers avaient adhéré sincèrement et librement à sa religion mais, en visite dans leur pays deux ans après les avoir abandonnés, il se rendit compte que les Tala avaient tourné le dos à cette religion. Désabusé et abattu, le missionnaire voulait comprendre pourquoi les Tala avaient tourné casaque. C’est son cuisinier Zacharie qui lui ouvrira les yeux en lui faisant ce terrible aveu : “Les premiers d’entre nous qui sont accourus à votre religion, y sont venus comme à une révélation, c’est ça une révélation, une école où ils acquerraient la révélation de votre secret, le secret de votre force, la force de vos avions, de vos chemins de fer… le secret de votre mystère, quoi ! Au lieu de cela, vous vous êtes mis à leur parler de Dieu, de l’âme, de la vie éternelle, etc. Est-ce que vous vous imaginez qu’ils ne connaissaient pas déjà tout cela avant, bien avant votre arrivée ? Ma foi, ils ont eu l’impression que vous leur cachiez quelque chose. Plus tard, ils s’aperçurent que, avec de l’argent, ils pouvaient se procurer bien des choses et, par exemple, des phonographes, des automobiles et un jour peut-être des avions. Et voilà ! Ils abandonnent la religion, ils courent ailleurs, je veux dire vers l’argent. Voilà la vérité, Père. Le reste, ce n’est que des histoires.” Merci, à toi, Mongo Beti, d’avoir posé, dans les années 50 déjà, ces questions de fond : quand l’Afrique en aura fini avec les coups d’état, les rébellions soutenues par certains pays occidentaux, la mauvaise gouvernance, la dictature, le tribalisme et tutti quanti, les Africains continueront-ils à remplir les églises ? Combien pourront déclarer comme Pierre : “A qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle” (Jn 6, 68) ? Quand chaque Africain aura plus que le minimum vital, le christianisme ne sera-t-il pas en crise comme il l’est actuellement en Occident ?
J’ai regretté et je regrette encore de ne t’avoir jamais rencontré car, de mon point de vue, tu fais partie des plus grands écrivains africains. En exil pendant plus de 30 ans en France, tu n’as cessé de militer pour la libération des peuples noirs. Mais tu ne t’es pas borné à dénoncer les ingérences étrangères prédatrices en Afrique, l’emprise de Foccart sur certains dirigeants africains, la coopération franco-africaine, une vaste escroquerie, selon toi, parce que ne profitant qu’à la France, la francophonie que tu considérais comme une institution pernicieuse et destructrice, etc. Tu t’en pris également au règne despotique et sanguinaire d’Ahidjo. Pour toi, Paul Biya était une “créature de François Mitterrand”, un “chef d’Etat fantôme” sous lequel la justice était devenue “une farce permanente et sinistre”. La corruption et le tribalisme des dirigeants africains ne trouvèrent jamais grâce à tes yeux. En te lisant, on peut soutenir avec André Djiffack qu’il y a chez toi “comme un mélange de Socrate par l’élévation de l’esprit, de Voltaire par l’effronterie à l’égard des pouvoirs institués, de Sartre par le militantisme impertinent et de Césaire par la lutte anticoloniale en vue de l’émancipation du monde noir” (cf. Mongo Beti, Le Rebelle, vol I, pp. 17-18). J’ajouterais, pour ma part, que tu étais comme obsédé par le “devoir d’être toujours aux côtés des humiliés qui luttent” (Che Guevara). C’est cette obsession qui te poussa à tancer le Guinéen Camara Laye à propos de son roman autobiographique L’Enfant noir: “Laye se complaît décidément dans l’anodin et surtout le pittoresque le plus facile […], érige le poncif en procédé d’art. […] C’est une image stéréotypée de l’Afrique et des Africains qu’il s’acharne à montrer : univers idyllique, optimisme de grands enfants, fêtes stupidement interminables” (cf. Le Rebelle, vol. I, p. 28). Le Congolais Boniface Mongo Mboussa, qui a préfacé les textes de Mongo Beti réunis et présentés par André Djiffack, te décrit comme “ce Prométhée camerounais qui nous lègue le feu”. Mais une chose est de recevoir le feu, une autre chose est de le garder allumé. Empêcherons-nous le tien de s’éteindre ? De l’endroit où tu te trouves maintenant, Mongo Beti, fais en sorte que les générations présentes et futures puissent poursuivre ton combat : le combat pour la justice et la liberté !
Jean-Claude Djereke
Prof. de Littératures francophones à Temple University, Philadelphia (USA).