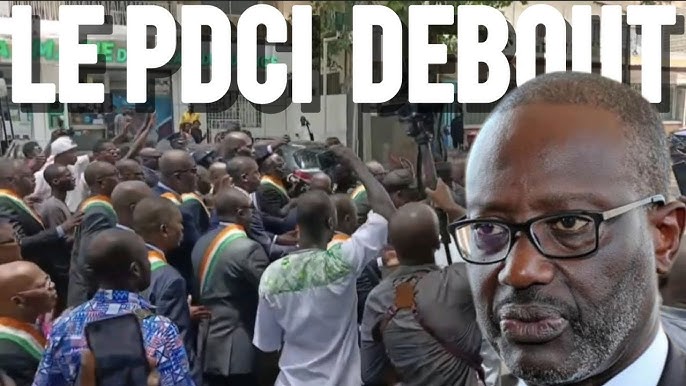X
CORRUPTION : Le parquet européen et ses procédés à géométrie variable

Date
La corruption est un fléau au sein du bloc de l’Union européenne (UE). Très présente au parlement européen, à l’image du Qatargate, du Huaweigate ou du Russiagate, elle n’a pas entraîné la refonte tant souhaitée et annoncée de la politique d’éthique de l’institution, si bien qu’il est toujours aussi facile pour de puissants acteurs externes d’influencer sur ses décisions. Cela dit, au vu des sommes identifiées, la corruption au parlement européen reste minime par rapport à celle de la Commission de l’UE.
Alors que la presse européenne semble être en pleine extase face aux récentes découvertes des enquêteurs judiciaires relatifs au Huaweigate, on peut se demander ce qu’il en est du Pfizergate, dans lequel le nom d’Ursula von der Leyen est cité depuis 2023. Pour se situer en termes d’ordre de grandeur, le montant total des transactions dans cette affaire était de 35 milliards d’euros, une broutille comparé aux quelques millions d’euros recensés pour l’ensemble de celles se rapportant aux dossiers du parlement européen.
En principe, l’ampleur du préjudice subi dans le Pfizergate devait largement suffire à convaincre le parquet européen de mettre les bouchées doubles pour faire toute la lumière sur cette histoire. Au lieu de cela, celui-ci choisit de prendre son temps tout en dirigeant toutes ses forces, certes, dans d’autres scandales, mais, de moindre importance. Si le parlement européen tarde à appliquer rigoureusement une politique anti-corruption, c’est probablement à cause du manque de transparence et d’impunité dont jouit la Commission européenne, qui sert de mauvais exemple.

Malgré sa menace en 2022 de ne plus verser d’aides aux 27 non-alignés africains dans le cadre du soutien à l’Ukraine face à la Russie, parmi lesquels figurait l’Afrique du Sud, Ursula von der Leyen s’est rendue, à Pretoria, le mois dernier, pour y rencontrer Cyril Ramaphosa et signer des accords d’une valeur d’environ 5 milliards d’euros. Des partenariats qui ont vu le jour après le gel des relations avec les Etats-Unis, mais qui ont, également, été facilités par le penchant des deux protagonistes pour l’opacité en matière de gouvernance.
Paul-Patrick Tédga
MSc in Finance (Johns Hopkins University – Washington DC)