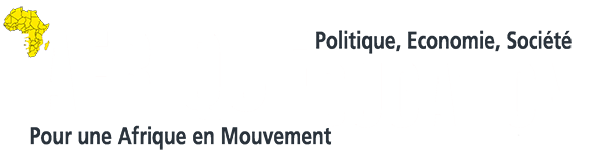X
COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Les cinq chefs d’Etat sous la menace d’une convocation
Date
L’Union Africaine (UA) vient de rater une occasion de se taire en cherchant à faire un chantage à la CPI (Cour pénale internationale) qui serait, selon elle, une organisation raciste qui ne juge que les dirigeants africains.
L’OUA (Organisation de l’unité africaine), devenue UA (Union africaine) ne s’est jamais montrée à la hauteur des attentes. Un exemple tout simple : après avoir pompeusement désigné, son candidat, au nom de toute l’Afrique, au poste de directeur général de l’Unesco, sur une proposition du président ougandais, Yoweri Museveni, l’UA a oublié, par la suite, d’accompagner cette candidature par un appui sur le terrain. Résultat : ce qui devait arriver arriva. Alors que ce candidat de l’Afrique, le Djiboutien Rachad Farrah par tait, au départ, avec les faveurs du pronostic, il a, finalement, été battu, à plate couture, dès le premier tour de l’élection, en octobre, par une Irina Bokova qui, pendant son premier mandat, avait tout fait pour humilier tout un continent de 54 pays. Le Prix Unesco-Obiang pour la Science qu’elle avait refusé de décerner aux lauréats, malgré la demande pressante du Conseil exécutif, en est la preuve éclatante. Juste parce que selon les critères de sa Bulgarie natale (qui serait devenue un bon exemple de démocratie), elle trouvait que la Guinée équatoriale était une affreuse dictature et que son président, Teodoro Obiang Nguema, ne méritait, aucunement, de tels honneurs, à cause de sa politique des droits de l’homme. Elle a fini par octroyer ce Prix après contrainte, trois ans après. Cause de son manque de volonté affirmé, il n’y a plus eu de deuxième édition du Prix Unesco-Obiang pour la Science, alors que les fonds sont disponibles.
Bref, l’UA est un vrai « machin » qui ne mérite pas d’exister, dans sa forme actuelle. Une organisation qui est incapable de faire ce qu’elle a décidé de réaliser, sans contrainte. Le cas Farah Rachad est une honte pour l’Afrique. Il faut parcourir les couloirs de l’organisation pour se rendre compte de la façon dont le continent s’est fait ridiculiser.
Avec quel pouvoir cette incompétente UA s’est-elle levée, un beau matin, pour menacer la Cour pénale internationale (CPI) sous prétexte qu’elle est empreinte d’une mentalité colonialiste ?
En effet, en réaction aux procédures de la Cour pénale internationale (CPI) visant deux chefs d’Etat et un vice-président soudanais et kenyans, l’Union africaine (UA) s’est réunie, en sommet extraordinaire, les 11 et 12 octobre, à Addis Abeba. En dépit du soutien à la justice internationale par un certain nombre d’Etats, manifesté au cours du sommet ou exprimé par leur absence, l’UA a adopté une décision qui va à l’encontre d’un des piliers de son mandat qu’est la lutte contre l’impunité des crimes les plus graves. Alors que l’impunité des dirigeants en exercice est consacrée, les victimes sont oubliées.
A ce sommet extraordinaire portant sur la relation de l’Afrique avec la CPI, l’UA a décidé que les chefs d’Etat et de gouvernement en exercice, ne devraient pas être poursuivis par la CPI,soutenant que cela risquait sinon de « saper la souveraineté, la stabilité et la paix » des Etats membres. Or, les 34 Etats africains parties au statut de la CPI s’étaient volontairement engagés lors de la ratification à consacrer l’égalité de chacun devant sa responsabilité pénale s’agissant de crimes internationaux.
Cette décision ternit tous les efforts de l’UA en faveur de la justice sur le continent et constitue un retour en arrière inquiétant, qui risque de servir de précédent et d’alibi pour de chefs d’Etat d’autres régions. Elle enfreint les dispositions de l’Acte constitutif de l’UA, va à l’encontre de l’intérêt et des obligations des Etats qui ont ratifié le statut de Rome, elle porte atteinte à l’indépendance de la CPI, elle viole le droit international pénal qui exclut toute exemption de responsabilité pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide. L’UA aurait dû rappeler, au contraire, à ses Etats membres qu’aucune poursuite de la CPI n’aurait été possible si les autorités nationales concernées avaient montré leur volonté et capacité de juger les auteurs des crimes les plus graves commis dans leur pays.
Dans sa décision, l’UA a appelé à ce que les procédures ouvertes à l’encontre des président et vice-président kenyans, respectivement, Uhuru Kenyatta et William Samoei Ruto, soient suspendues par le Conseil de sécurité des Nations-Unies, en ver tu de l’article 16 du statut de la CPI. Si le Conseil de sécurité n’a pas le pouvoir de clôturer une procédure judiciaire de la CPI, il peut demander à ce que la CPI sursoie pendant 12 mois aux enquêtes et poursuites engagées lorsqu’il peut alléguer d’une menace à la paix et à la sécurité internationale, en application du chapitre 7 de la Char te des Nations-Unies. Or, ce sont la commission de crimes internationaux et l’impunité de leurs auteurs qui constituent la menace la plus grave à la paix et la sécurité et non l’intervention de la CPI.
Afin d’entamer les négociations avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et de pousser à l’application de cette procédure de sursis d’enquête et de poursuite concernant la situation du Kenya, l’UA a annoncé la création d’un Groupe de contact du Conseil exécutif de l’UA présidé par le président en exercice du Conseil et composé de cinq représentants d’Etats membres de l’UA.
Les pays africains ont joué un rôle décisif dans la création de la CPI et l’entrée en vigueur de son statut le 1er juillet 2002. Quatre chefs d’Etat africains ont eux-mêmes demandé au procureur de la CPI d’ouvrir une enquête sur les crimes qu’ils étaient en incapacité de juger. Il est déplorable de constater que les attaques répétées contre l’action de la CPI menées par certains chefs d’Etat n’ont véritablement commencé que lorsque deux d’entre eux ont fait l’objet de poursuites. Il est évident que la défense de leurs propres intérêts l’emporte sur toute considération de justice pour les victimes de ces crimes odieux, et hypothèque gravement les espoirs de consolidation de la paix sur le continent.
L’article 27 du statut de la CPI énonce que « le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Ceci a été accepté par 34 des 54 membres de l’Union africaine qui ont ratifié le statut de Rome. Dans le cas du Kenya, il faut également souligner que la constitution kenyane, notamment, en son article 143(4) interdit l’extension de l’immunité accordée au président de telle sorte qu’elle le soustrairait à des poursuites pénales en ver tu de traités auxquels le Kenya est partie et qui eux-mêmes interdisent ce type d’immunité.
Depuis le début du 20e siècle, il est reconnu qu’il existe des crimes si graves qu’ils méritent une action internationale ; l’action d’une juridiction internationale n’est donc pas contraire à la souveraineté des Etats, a fortiori si ceux-ci ont accepté sa compétence. Au contraire, face à la commission d’atrocités, une réaction judiciaire internationale, faute de justice nationale, est primordiale pour le respect des droits des victimes et la consolidation de la paix.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a reconnu que les immunités accordées aux étrangers – parmi lesquelles celles accordées aux chefs d’Etat – doivent être interprétées de la façon la plus restrictive possible. Selon le droit international, les chefs d’Etat peuvent jouir d’une immunité vis-à-vis des juridictions d’autres pays, afin de leur permettre d’exercer sans difficulté leurs fonctions de gouvernants. Néanmoins, la commission présumée de crimes internationaux ne fait pas partie de ces fonctions. Il a été déjà reconnu par la Cour internationale de justice que les immunités ne sont pas opposables devant les juridictions pénales internationales. Depuis 1945 et les procès contre les dirigeants nazis à Nuremberg, l’immunité des chefs d’Etat n’est pas considérée comme une cause absolutoire de leur responsabilité pénale. Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, ont aussi insisté sur ce principe, ainsi que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et les Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais ayant engagé en début d’année, « au nom de l’Afrique » sur décision de l’UA, des poursuites à l’encontre de l’ancien chef d’Etat tchadien Hissène Habré.
Si l’UA a décidé de se, vivement, remuer, elle qui bouge, rarement, c’est parce que le feu couve sous la cendre. Il n’y a pas que le cas du Soudanais, Omar el Béchir, à qui Washington a refusé le visa pour se rendre aux68e Assemblées Générales des Nations-Unies, à New York, en septembre dernier, violant par la même occasion les accords de siège signés entre le gouvernement des Etats-Unis et l’ONU, qui fait problème, ni le plus récent, celui du président kenyan, Uhuru Kenyatta, appelé à comparaître à la CPI, à par tir du 12 novembre 2013. Les chefs d’Etat africains craignent que la machine de la CPI puisse s’emballer contre eux, les privant, dans le futur, de toute marge de manœuvre. Car, à l’évidence, plusieurs d’entre eux sont sous le coup d’une (possible) inculpation, même si personne n’en parle encore pour le moment. Les faits qui leur sont reprochés restent imprescriptibles et font pendre l’épée de Damoclès sur leur tête, quand ils ne disposeront plus d’immunité que leur procure la fonction de chef d’Etat. Ils sont nombreux à être, secrètement, inquiets, surtout, au regard du sort réservé aux anciens chefs d’Etat : le Libérien Charles Taylor et l’Ivoirien Laurent Gbagbo.
Puissants aujourd’hui car bénéficiant d’un statut qui les rend intouchables, ces chefs d’Etat africains, menacés, s’appellent, le Rwandais Paul Kagame, l’Ivoirien Alassane Ouattara, le Congolais Denis Sassou Nguesso, le Burkinabé Blaise Compaoré et le Tchadien Idriss Déby Itno. Quatre des cinq chefs d’Etat font partie de la sphère francophone, ce qui montre que la françafrique joue un très mauvais rôle dans l’évolution des Etats concernés car les dirigeants de ces derniers sont fortement décriés. Redoutant l’issue qui peut leur être réservé s’ils quittaient le pouvoir, ils se démènent comme ils peuvent pour rester au pouvoir et y mourir que d’affronter les foudres de la justice internationale dont on connait la rigueur. Même si la plupart d’entre eux peuvent être accusés de crimes économiques, c’est plutôt les crimes de sang et de génocide ou d’assassinats en série, imprescriptibles dans le temps et dans l’espace, qui les rendent vulnérables.
Paul Kagame, président du Rwanda, est accusé, de génocide sur les Hutu, de 1996 à 1998, par le Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, dans un rapport publié en août 2010. Des massacres sans précédent s’y sont déroulés, sous la responsabilité du nouveau pouvoir rwandais qui voulait étouffer dans l’œuf, toute possibilité de représailles venant des Hutu contre la communauté tutsi, installée au pouvoir à Kigali depuis 1994, après avoir elle-même été victime d’un génocide de près de 800.000 personnes, selon une estimation basse des Nations-Unies. D’autre part, des officiers-militaires proches de Paul Kagame, dans le maquis, affirment qu’il est la personne qui avait tiré le missile sol-air sur le Falcon 50 qui transportait les chefs d’Etat du Rwanda, Juvénal Habyarimana, et du Burundi, Cyprien Ntaryamira, ainsi que leurs collaborateurs. C’est cet acte terroriste qui provoqua le déclenchement des tueries massives, les extrémistes hutu, profitant de l’assassinat du président, voulaient en finir avec la minorité tutsi. Ces crimes sont imprescriptibles et susceptibles de conduire Paul Kagame à la CPI, à tout moment, et surtout, quand il ne sera plus chef d’Etat. On comprend d’ailleurs pourquoi il pratique le monopartisme sans le dire à haute voix. La liber té d’expression pour rait lui coûter cher. Il fait par ailleurs partie du Top 5 des chefs d’Etat africains en flèche dans l’accusation de la CPI.
Dramane Ouattara, président de Côte d’Ivoire, a immédiatement envoyé à la CPI, fin 2011, son rival, Laurent Gbagbo,contre qui il avait fait la guerre post-électorale de fin 2010 à avril 2011, totalisant au bas mot, 3.000 morts selon les Nations-Unies. Les deux camps politiques s’étaient livrés à des massacres inqualifiables. Mais curieusement, à ce jour, seul l’ancien président ivoirien se retrouve à la CPI. Dans le camp d’en face, personne. Au contraire, tous les chefs de guerre, à commencer par Guillaume Soro devenu le très honorable président de l’Assemblée nationale, ont été nommés dans l’administration civile ou militaire. Si Alassane Ouattara est encore libre de ses mouvements, on suppose que c’est parce qu’il bénéficie de l’immunité en tant que président de la République. Mais le jour où il ne sera plus président de Côte d’Ivoire, son successeur aura l’obligation de l’arrêter pour le transférer à la CPI, y compris ses chefs de guerre des Forces (dites) nouvelles. Ce n’est donc qu’une question de temps, les crimes commis étant imprescriptibles.
Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville. La simple idée de pouvoir se retrouver, un jour, après 2016, quand il ne sera plus président de la République, devant la justice internationale (ou française) peut lui provoquer un AVC. Il en est malade et ne dort plus depuis que la justice française, au TGI de Paris, a rouvert le dossier sur l’Affaire des 353 disparus du Beach, malgré les protestations du pouvoir de Brazzaville. Ancien ministre délégué à la présidence chargé de la Défense nationale, Justin Lekoundzou Itihi Ossetoumba, a déjà été auditionné par des enquêteurs en août et septembre. Il en est de même du général Norbert Dabira, un des responsables de l’armée, à Brazzaville, au moment des faits. Quant au général Pierre Oba qui fut ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, pendant cette période, ses deux résidences de la région parisienne, ont été perquisitionnées courant octobre. Ayant pu échanger au téléphone avec un des enquêteurs, il leur a donné rendez-vous pour le 23 octobre 2013 pour une audition en bonne et due for me. Mais entre temps, le président Denis Sassou Nguesso, redoutant le pire sur sa personne, a interdit quiconque de répondre favorablement à toute convocation d’un juge français. Le bras de fer ne fait que commencer entre la justice française et le pouvoir congolais. Il faut ajouter que cette affaire avait été jugée pendant l’été 2005, par la Cour d’Appel de Brazzaville qui avait relaxé tous les mis en cause en octroyant une indemnité de quelques maigres millions de f cfa aux familles éplorées. Un véritable scandale qui avait poussé ceux des Congolais par fois binationaux ayant échappé aux massacres et présents sur le territoire français à porter plainte en France. Cette affaire est un véritable boulet pour Sassou Nguesso sans compter d’autres massacres commis en 1997 quand il évinça, par les armes, Pascal Lissouba, président démocratiquement élu, du pouvoir, et aussi, en 1998 et 1999, quand il chercha à exterminer toute une population du Pool parce qu’elle lui est électoralement hostile. Le président congolais est aussi crédité de l’assassinat du président du Congo, Marien Ngouabi, en 1977, de l’ancien président Alphonse Massamba-Débat et du cardinal Emile Biayenda, pour ne citer que ces exemples. Sinon, la liste de ses victimes est kilométrique et il ne fait d’ailleurs pas mystère de sa convocation à la CPI, quand il se sera libéré de sa charge de président de la République en 2016.
Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, a à son actif d’avoir assassiné son « alter ego », Thomas Sankara, le 15 octobre 1987, alors qu’il était chargé de sa sécurité. Depuis cette date, il est entré dans un cycle d’assassinats qui lui a permis d’exterminer tous ses rivaux dans l’armée. Ayant fait le vide autour de lui, il s’en est pris aux pays voisins de la sous-région, notamment, le Liberia, la Sierra Leone, et plus tard, la Côte d’Ivoire dont la rébellion fut accueillie, formée et entraînée dans les camps militaires au Burkina Faso.
Lors de son procès au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, l’ancien président du Liberia, CharlesTaylor, avait cherché à l’impliquer dans sa défense afin de diluer certaines de ses responsabilités, sans succès. Compaoré avait réussi à zigzaguer grâce à ses complicités internationales, laissant Taylor se mélanger, seul, les pédales. Pour tant, ce dernier avait raison de l’impliquer dans son plaidoyer. Pour preuve, le dossier de l’accusation compte 7.000 pages dans lesquelles il est question de Blaise Compaoré sur les 40.000 pages qu’il totalise. Il n’est pas étonnant qu’il cherche activement à modifier la constitution pour pouvoir se représenter en 2015. Le pouvoir est sa seule planche de salut. Autrement dit, ses crimes passés risquent de le conduire droit à la CPI quand il redeviendra simple citoyen.
Idriss Déby Itno, président du Tchad, a financé le Tribunal spécial du Sénégal afin que son prédécesseur Hissène Habré soit jugé et condamné. Le rôle de Déby est trouble car en 23 ans de pouvoir, les organisations des droits de l’homme lui attribuent jusqu’à 40.000 morts, dans tous les domaines, y compris dans les multiples guerres qu’il ne cesse de mener pour conserver son pouvoir. A côté de lui, Hissène Habré qui est aujourd’hui enfermé à Dakar, n’est qu’un enfant de chœur.