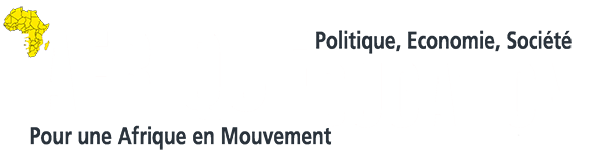X
DEBAT : Fatou Diome contre une idéalisation de l’Europe

Date
Le point de départ de Le Ventre de l’Atlantique, publié en 2003 aux éditions Anne Carrière, est la belle victoire des Lions de la Teranga, l’équipe nationale du Sénégal, sur les Bleus de France pendant le match d’ouverture de la Coupe du monde de football de 2002. Cette victoire n’a pas seulement procuré du bonheur et de la fierté à la jeunesse sénégalaise passionnée du ballon rond. Elle lui a donné aussi des idées : par exemple, jouer en Europe et y gagner beaucoup d’argent comme El Hadji Diouf et d’autres. Madické fait partie de ces jeunes sénégalais qui aimeraient faire une belle carrière dans un club européen. Il compte, pour réaliser son rêve, sur sa sœur qui vit en France depuis dix ans. Mais Salie est loin d’adhérer à un tel projet. Pourquoi y est-elle peu favorable ? Pourquoi ne souhaite-t-elle pas que Madické parte de leur île de Niodior ? D’abord, parce qu’elle-même a souffert en France du racisme et de la solitude et parce qu’elle est obligée de jongler pour régler les factures d’eau, d’électricité et de téléphone; ensuite, parce que les Africains n’ayant ni formation ni papiers en France s’exposent à faire les travaux les plus durs et à être exploités par des employeurs qui ne pensent qu’à faire du profit. À mon avis, la vérité sur la vie des immigrés africains en Europe se trouve dans cet argumentaire de Salie ; elle n’est pas dite par l’homme de Barbès qui, pour se faire valoir, fait croire à ses amis et parents restés en Afrique que la vie est belle en Occident tout en se gardant de dire que, avant de « réussir », il a connu les taudis, la galère, les conditions de vie misérables. Salie parvient-elle à convaincre son jeune frère ? Malheureusement, non car, même si Madické croit l’échec possible, il reste persuadé qu’il peut enflammer les stades, se faire une place en France, y faire fortune, bref y rencontrer la gloire et le succès. L’instituteur du village, Ndétare, échouera, lui aussi, à le faire changer d’avis. Et pourtant, quelle justesse dans ses propos ! On ne peut que se rallier à lui quand il invite à ne pas canoniser tout ce qui se fait en Afrique et en Europe ; on ne peut que lui donner raison quand il affirme : « La modernité nous laisse en rade. En dehors de la pilule, tout reste à faire. Et même la pilule, je crois qu’il faudrait la programmer dans un riz génétiquement modifié afin d’obliger les femmes à s’en servir; si seulement les féodaux qui leur servent d’époux pouvaient arrêter de mesurer leur virilité au nombre de leurs enfants. Ça aussi, petits, c’est le sous-développement et ça se joue dans les mentalités. Essayez de ne pas reproduire les erreurs de vos pères et vous verrez que, même sans aller à l’étranger, vous aurez plus de chance qu’eux de vous en sortir ici. D’accord, soyez prêts au départ, allez vers une meilleure existence, mais pas avec des valises, avec vos neurones ! Faites émigrer de vos têtes certaines habitudes bien ancrées qui vous chevillent à un mode de vie révolu. La polygamie, la profusion d’enfants, tout cela constitue le terreau fertile du sous-développement. Nul besoin de faire des mathématiques supérieures pour comprendre que plus il y a de gens, moins grande est la part de pain à partager. »
Pourquoi Madické et d’autres jeunes sénégalais croient-ils dur comme fer que c’est seulement en France qu’ils auront une vie meilleure ? Parce qu’ils souffrent d’une grave maladie que Diome appelle la colonisation mentale. C’est cette maladie qui pousse un bon nombre de jeunes de Niodior à penser que « tout ce qui est enviable vient de France : la seule télévision qui leur permet de voir les matchs, elle vient de France, son propriétaire, devenu un notable au village, a vécu en France ; l’instituteur, très savant, a fait une partie de ses études en France ; tous ceux qui occupent des postes importants au pays ont étudié en France ; les femmes de nos présidents successifs sont toutes françaises ; les quelques joueurs sénégalais riches et célèbres jouent en France ». Salie, on l’a déjà dit, est d’un avis contraire. Mais, si elle ne voit pas la France comme un Eldorado, pourquoi continue-t-elle d’y vivre ? Pourquoi est-elle partie de Niodior ? Elle est partie parce que son père n’était pas du village. Or, dans cette communauté, les étrangers et leurs enfants n’avaient pas voix au chapitre. Ils n’étaient pas les bienvenus sous l’arbre à palabres. Le père de Madické, lui, était du village. Il y était né et y avait grandi. Salie pense, par conséquent, que Madické n’a pas besoin de venir en France pour se réaliser ; elle est prête à lui venir en aide mais à condition qu’il veuille faire quelque chose sur place.
Ce roman aborde aussi la question des rapports qu’entretiennent les gens du pays avec ceux qui vivent en France. Salie se demande ainsi si les coups de fil qu’elle reçoit de Dakar et d’autres villes sont toujours désintéressés, si ses parents « viennent la fêter ou lui soutirer quelques billets » quand elle est en vacances au pays.
Mais Diome ne tape pas que sur les Africains dans ce roman. Elle décoche aussi des flèches à l’Europe, comme dans ce passage : « Mieux que le globe terrestre, le ballon rond permet à nos pays sous-développés d’arrêter un instant le regard fuyant de l’Occident, qui, d’ordinaire, préfère gloser sur les guerres, les famines et les ravages du sida en Afrique, contre lesquels il ne serait pas prêt à verser l’équivalent d’un budget de championnat. »
Si l’auteure use de formules-chocs dans son roman (par exemple, « la pauvreté, c’est la face visible de l’enfer, mieux vaut mourir que rester pauvre », « le tiers-monde ne peut voir les plaies de l’Europe, les siennes l’aveuglent » ou encore « pour les pauvres, vivre c’est nager en apnée en espérant atteindre une rive ensoleillée avant la gorgée fatale »), c’est uniquement pour faire pièce à « l’obsession de la France » nourrie notamment par la télévision, petite boîte magique ramenée justement de l’Hexagone par le venu de France ». Le prix de cette obsession de l’ailleurs qui serait meilleur que l’ici, c’est souvent la mort lors de la traversée de la Méditerranée. Combien de vies fauchées ou perdues dans cet océan, en effet ! Et on comprend mieux pourquoi Diome a choisi d’intituler son roman « Le Ventre de l’Atlantique » : pour faire comprendre que l’océan peut tuer comme il tue chaque jour des pêcheurs mais aussi nombre de jeunes africains qui pensaient fuir l’enfer du chômage et de la misère alors qu’ils avaient rendez-vous avec la mort. C’est en cela que le roman de Diome peut être vu comme une prémonition de la tragédie des candidats à l’émigration utilisant des bateaux de fortune pour gagner l’Europe idéalisée.
Je voudrais terminer cette brève recension de Le ventre de l’Atlantique par le bel hommage que Fatou Diome (notre photo) rend à son ancien instituteur. « Il m’a tout donné : la lettre, le chiffre, la clé du monde », écrit-elle. Et elle ajoute : « Il arrive qu’un individu devienne le centre de votre vie, sans que vous ne soyez lié à lui ni par le sang ni par l’amour, mais simplement parce qu’il vous tient la main, vous aide à marcher sur le fil de l’espoir ». En lisant ces mots, je n’ai pu m’empêcher de penser à tous ces hommes et femmes qui guidèrent nos premiers pas sur le chemin du savoir, qui nous mirent le pied à l’étrier, qui se donnèrent tant de mal pour que nous apprenions à compter, à lire et à écrire. Certains d’entre eux sont partis de ce monde, prématurément parfois, parce qu’ils n’avaient pas de quoi payer un médicament qui coûtait 2.000 F CFA. Ils voulaient pourtant que nous allions le plus loin possible ; ils souhaitaient que chacun de leurs élèves devienne quelqu’un, c’est-à-dire, un citoyen honnête et patriote.
Jean-Claude DJEREKE
Professeur de littérature africaine à
Temple University (Etats-Unis).