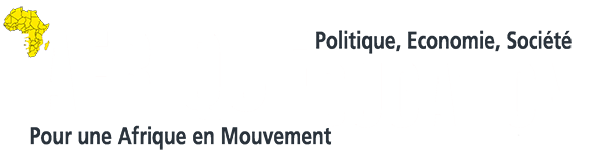X
ESCLAVAGE : Femmes, grandes oubliées de l’histoire de la traite

Date
Majoritaires dans les exploitations coloniales dès le XVIIIe siècle, les femmes constituaient un rouage essentiel de l’entreprise esclavagiste, autant pour leur force de travail que pour leur fertilité. La place qu’elles occupent dans les recherches historiques a pourtant été très longtemps marginale.
ll y a 35 ans, j’ai publié une monographie intitulée Natural Rebels: A Social History of Enslaved Black Women in Barbados (Rebelles-nées : une histoire sociale des femmes noires esclaves à la Barbade, non traduit). Elle a vu le jour à la suite d’une protestation dans le cadre de mon séminaire d’histoire à l’Université des Indes occidentales. Des étudiantes se sont élevées contre le fait que mes présentations négligeaient les femmes esclaves, pourtant, majoritaires dans les colonies pendant la plus grande partie de la période esclavagiste. J’ai promis de me plonger dans les archives afin de rectifier cette situation : une sorte de réparation pédagogique.

Ce livre était le premier du genre ; l’historiographie de l’esclavage dans les Caraïbes s’en est trouvée changée. Le mouvement vers la justice de genre dans le discours historique avait commencé. Depuis, nous avons assisté à une explosion des recherches et publications sur la vie des femmes esclaves. La production littéraire est encore plus vaste. Elle constitue désormais la base empirique de la défense publique en matière de réparations pour l’esclavage. Une fois de plus, je me suis retrouvé entraîné par des étudiants à l’avant-garde d’un mouvement d’idées.
Mes étudiantes activistes n’étaient pas toutes féministes, mais, elles avaient toutes besoin de connaître les raisons de ce silence historiographique, en réalité, un vide, autour de ce qui aurait manifestement dû constituer le point de départ de la recherche. Certaines voulaient savoir, par ailleurs, si j’avais hérité des préjugés des générations précédentes de chercheurs, et si je n’avais pas résisté à ces raisonnements. Après une année de recherches épuisantes dans les archives des Caraïbes, j’ai replongé mon esprit désormais très curieux dans les documents de l’empire britannique.
Prise de conscience
La « découverte » de Londres s’est faite à la manière de Christophe Colomb. Les faits étaient là depuis toujours, attendant qu’un aventurier induit en erreur les découvre. Voici ce que j’ai trouvé : les données sur l’esclavage dans les plantations font davantage référence aux conditions de vie des femmes esclaves qu’à celles des hommes esclaves. Pourquoi, alors, les historiens n’en ont-ils pas tenu compte au cours d’un siècle d’écrits sur l’esclavage ? La réponse semblait assez simple : la mentalité masculine ne favorisait pas une analyse objective du genre.

Les données démographiques doivent être étudiées de manière approfondie. Les esclavagistes des plantations préféraient recourir majoritairement à la main-d’œuvre masculine uniquement dans les phases préliminaires de l’aménagement des infrastructures plantationnaires. Une fois les arbres enlevés et les fossés creusés, ils estimaient que les femmes étaient plus productives et plus efficaces pour l’entretien des plantations.
Dans les Caraïbes anglaises, au milieu du XVIIIe siècle, la préférence allait aux femmes. C’est la Barbade qui a ouvert la voie. Dès les années 1730 et jusqu’à la fin de l’esclavage dans les années 1830, les femmes noires ont été plus nombreuses que les hommes noirs. Ce fut une prise de conscience existentielle pour mes élèves, et elles ont eu besoin d’un récit expliquant pourquoi cette réalité n’était pas reflétée dans les analyses historiques.
Laveuses, couturières ou domestiques
Dans la plupart des villes coloniales, les femmes esclaves constituaient la majorité des travailleurs. Elles étaient laveuses, couturières, cuisinières, domestiques, prostituées et vendeuses ambulantes. Elles étaient « louées » par leurs propriétaires, à qui elles devaient remettre l’argent gagné. Ces tâches très diverses faisaient que les villes, comme les plantations, ne pouvaient pas survivre ni prospérer sans leurs services. Elles représentaient également un secteur économique qui permettait aux femmes blanches de gérer leur propre activité. La majorité des femmes esclaves urbaines appartenaient à des femmes blanches dont la participation financière dans le secteur des plantations rurales était en revanche minoritaire.
Ce qui était vrai dans les colonies britanniques l’était aussi dans les territoires français et néerlandais. Partout, le système esclavagiste reposait sur le principe juridique selon lequel seule une femme esclave pouvait donner naissance à un enfant esclave. La femme noire était donc la porteuse biologique et légale du statut de bien mobilier. Elle était la principale source de travail productif et de capacité de reproduction. Son enfant, qu’il soit engendré par un homme noir ou blanc, était comptabilisé comme un actif dans les livres de comptes. Elle était donc considérée comme un « bien parfait ». Elle représentait une force de travail, se reproduisait et procurait des plaisirs socio-sexuels sous la contrainte à son propriétaire. Le modèle économique de l’esclavage était donc fondé juridiquement, économiquement et socialement, sur le statut de bien mobilier des femmes noires esclaves.

Au cœur de l’entreprise esclavagiste
Dans ce contexte, la femme noire esclave était donc surexploitée et se trouvait au cœur de l’entreprise esclavagiste. Le système colonial tirait d’elle plus de richesses et de services que de ses homologues masculins. Elle constituait le principal facteur de pérennité de l’esclavage. Sa fertilité et sa maternité, ainsi que, ses bras et ses jambes dans les champs, se combinaient pour en faire une « super esclave » aux yeux des esclavagistes. Pourtant, c’est précisément les tentatives de régulation de sa fertilité qui ont fait d’elle une « rebelle-née » désireuse de protéger son intimité des esclavagistes.
Le système colonial tirait de la femme noire esclave plus de richesses et de services que de ses homologues masculins
Le mouvement de justice réparatrice, qui repose sur le postulat que l’esclavage est un crime contre l’humanité, devrait donc partir du principe que les esclaves n’étaient pas égaux entre eux. Les femmes ont supporté la plus grande part du fardeau et toute notion d’indemnisation devrait être fondée sur ce constat.
Le mouvement de justice réparatrice devrait partir du principe que les esclaves n’étaient pas égaux entre eux
Le mouvement de réparation de la CARICOM a intégré cette vérité dans son plaidoyer et sa méthodologie de calcul monétaire. La convergence de la recherche historique et du discours public à cet égard représente un point de bascule important dans ce qui était jusqu’à présent un récit essentiellement masculin. Les grands mouvements commencent par de petites questions dans des espaces habituellement paisibles. Les universitaires ont la responsabilité de répondre aux interpellations faites en salle de classe et de partir à la recherche de solutions radicales à ce type de questions. De la réflexion sur le genre au débat sur les réparations, les femmes se heurtent toujours aux murs historiques du savoir masculin dans leur recherche de la vérité et, surtout, luttent pour que cette réflexion soit menée.
Un riche patrimoine immatériel
La tradition du théâtre dansé Cocolo s’est développée parmi les descendants d’esclaves des Caraïbes britanniques venus en République dominicaine au milieu du XIXe siècle pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Cette communauté, linguistiquement et culturellement, distincte, a fondé ses propres églises, écoles, sociétés de bienfaisance et services d’entraide. La tradition du théâtre dansé, qui en est l’une des expressions culturelles les plus spécifiques, est inscrite depuis 2008 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. D’autres expressions culturelles liées à la mémoire des descendants des personnes mises en esclavage figurent également sur la Liste, à l’image de la samba de roda de Recôncavo de Bahia (Brésil), du carnaval de Barranquilla (Colombie), des traditions des Marrons de Moore Town (Jamaïque), ou encore, du maloya (Ile de la Réunion).
Hilary McD. Beckles
Professeur d’histoire économique et sociale, vice-chancelier de l’Université des Indes occidentales de Kingston (Jamaïque).