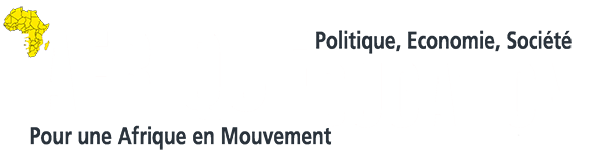X
LA MODERNISATION DE L’ETAT AU CAMEROUN Par Marcelin NGUELE ABADA*
Date
Au Cameroun, la transition vers la démocratie fut amorcée par d’importantes réformes de règles du jeu politique. Dès 1990, une législation plus libérale est adoptée avec notamment la législation des partis politiques. En 1991, une importante révision constitutionnelle est adoptée qui prévoit une responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale. En 1996, la réforme prend de l’ampleur à la faveur d’un bouleversement du régime constitutionnel qui accroît incontestablement la libéralisation du fonctionnement du régime.
Contrairement au processus béninois par exemple, le président Paul Biya a entendu garder l’initiative en réussissant a éviter la tenue d’une conférence nationale selon le modèle béninois. Il a réussi à bouleverser le socle juridique dans la continuité politique. Si la modernisation des institutions trouvait aussi ses origines dès 1982, date de l’accession du Président Biya à la magistrature suprême, les changements majeurs remontent en 1990.
1982 a certes ouvert la voie à une décrispation politique en permettant aux populations de respirer un air nouveau grâce à un discours nouveau et une thématique politique novatrice. Celui qui avait des allures de Gorbatchev grâce au Renouveau National , a, fort des expériences de 1983 et 1984, choisi d’opérer les changements au sein du même système.
C’est cet élan de 1982 qui a sauvé la République : l’Etat par rapport au parti et qui, une dizaine d’années plus tard, évite le désastre politique. La crise économique n’a pas disparu, l’intégration nationale est en chantier. Le Renouveau doit moderniser la vie politique : il doit donner l’impulsion par les réformes en profondeur, il doit intégrer les contre-pouvoirs, gage de toute crédibilité de l’action politique.
La modernisation de l’Etat vise non seulement les structures horizontales du pouvoir (I), mais également les logiques verticales du pouvoir (II).
I- LA MODERNISATION DES STRUCTURES HORIZALES DU POUVOIR
Le Cameroun a inscrit ses réformes institutionnelles dans le sillage, toutes proportions gardées, de la doctrine de Montesquieu notamment en ce qui concerne la limitation du pouvoir par sa division. La théorie de la séparation des pouvoirs y est devenue du moins depuis les réformes constitutionnelles du 23 avril 1991 et du 18 janvier 1996, un élément du cahier de charges dans le vaste chantier de la démocratisation.
Mythe démocratique et même une des conditions de la réalisation de l’Etat de droit, la séparation des pouvoirs est devenue au Cameroun une projection politique, puisque les révisions institutionnelles rappelées, ne permettent pas de classer le régime dans telle ou telle catégorie.
Régime par conséquent atypique, le constituant a opéré un certain nombre de mutations faisant de l’organisation séparée des pouvoirs un dogme du constitutionnalisme à l’aube du nouveau millénaire.
A travers deux importantes mutations constitutionnelles, l’Etat camerounais a non seulement opté pour la modernisation des institutions politiques, mais aussi consacré l’institutionnalisation des contre-pouvoirs.
A- La modernisation des institutions politiques
La constitution unitaire du 2 juin 1972 traduisait à souhait la magnificence présidentielle. L’évolution constitutionnelle jusqu’en l990-1991 ne suscite aucune curiosité particulière. L a redistribution du pouvoir opérée par la révision constitutionnelle du 23 avril 1991, renforcée par celle du 18 janvier 1996 marque une rupture nette avec la surpuissance de l’exécutif. La réforme vise non seulement une constitutionnelle progressive de la dyarchie de l’exécutif, mais également une montée en puissance du pouvoir législatif.
1- La constitutionnalisation de la dyarchie du pouvoir exécutif
Les révisions constitutionnelles de1991 et 1996 ont mis en place un système qui allie complexité et ambiguïté. La création d’un poste de premier ministre, chef du gouvernement, opère un nouvel équilibre au sein de l’exécutif. Cet équilibre doit fonctionner sur la base d’un présidentialisme autoritaire qui se manifeste dans la répartition des pouvoirs entre le chef de l’Etat et le » chef du gouvernement « . L’évolution constitutionnelle permet de renforcer l’efficacité de l’action publique et surtout, de trouver un coupable désigné en la personne du premier ministre devenu, sur ses entrefaites, le bouc émissaire des dérapages politiques.
L’institution d’un premier ministre n’est pas nouvelle au Cameroun. Le pays a connu une période de parlementarisme entre les années 1950-1960 qui ont vu successivement André Marie Mbida et Ahmadou Ahidjo, premiers ministres et chefs du gouvernement dans un régime parlementaire. Pendant la période fédérale, les fonctions de premier ministre avaient une influence uniquement au niveau des structures fédérées. L’avènement de l’Etat unitaire va renouer vers 1975 avec l’institution, mais dans le cadre d’un régime présidentialiste.
L’intérêt du poste va ressurgir en 1979 lorsque le premier ministre devient le successeur constitutionnel du président de la République dans tous les cas de vacance. Le 6 novembre 1982, Paul Biya alors premier ministre succède à Ahmadou Ahidjo démissionnaire. Deux années plus tard soit en 1984, une révision constitutionnelle supprime le poste de premier ministre en raison de la conjoncture politique.
L’ouverture de l’espace politique aux forces de distanciation dans les années 1990 va conduire à un réajustement institutionnel qui résonne comme une véritable révolution.
Le 23 avril 1991, le premier ministre devient une composante du pouvoir exécutif, disposant de compétences importantes sur le double plan politique et administratif. Cette option est confirmée le 18 janvier 1996 à la faveur d’une importante révision constitutionnelle. Si les fonctions de président de la République, chef de l’Etat n’ont pas été affectées, les missions de chef du gouvernement ont été, quant à elles, consacrées. Chef du gouvernement, le premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il n’a pas une politique propre puisqu’il applique la politique définie par le chef de l’Etat. Par conséquent , sa responsabilité politique vis-à-vis de la majorité parlementaire relève d’un habillage constitutionnel dans les régimes présidentialistes.
Ce qui avait tout l’air d’une réforme en profondeur semble faire du premier ministre un obligé du président de la République. Devenu » le bouc émissaire » des dossiers brûlants, le premier ministre dispose de très peu de manœuvres au plan politique.
Au plan administratif, le premier ministre est titulaire du pouvoir réglementaire. Au moins, il est chargé de l’exécution des lois, il nomme aux emplois civils, il dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’observation de la pratique amène à penser que le premier ministre dispose de beaucoup de marges de manœuvres pour conduire la politique nationale. Interlocuteur des institutions financières internationales, le premier ministre est l’homme ou la femme qui doit œuvrer à la construction des solidarités nationales en oubliant toute ambition politique.
2. La réforme du rôle du parlement
Le schéma constitutionnel mis en place après les indépendances avait considérablement affaibli le parlement à la fois dans son mode de travail et dans ses domaines d’intervention. Les réformes constitutionnelles de 1991 et 1996 tentent de réorganiser le rôle du parlement. Non seulement, la représentation nationale a vu son rôle de législateur renforcé, mais également, le constituant lui a confié la charge de contrôler l’action gouvernementale. Nous assistons ici à un glissement vers un régime semi-présidentiel qui nécessite encore de réformes d’envergure notamment au niveau de la responsabilité politique du gouvernement et au niveau de la maîtrise par les parlementaires de l’ordre du jour de leurs travaux et du droit d’amendement.
En ce qui concerne les avancées, il évident que le statut du parlement résulte de la constitution. Les dernières révisions ont modifié le schéma classique. Le principe de bicaméralisme a été retenu puisque le parlement comprend désormais l’Assemblée nationale et le Sénat. Mis à part les occasions pendant lesquelles les deux chambres du parlement siègent en congrès, il convient de souligner qu’elles ont chacune sa spécificité.
Le bicamérisme camerounaise est inégalitaire. L’Assemblée nationale élue au suffrage universel direct, ne dispose pas davantage de compétence et la Chambre haute, survivance historique, dispose d’une fonction marginale. Celle-ci assure la représentation des collectivités territoriales. L’intérêt de cette réforme constitutionnelle est de permettre au Parlement de s’informer sur l’activité gouvernementale. A cette fonction informative, il faut associer celle plus coercitive de mise en jeu de la responsabilité politique du gouvernement, soit à l’initiative du premier ministre au moyen d’une question de confiance, soit à l’initiative des députés, au moyen cette fois, d’une motion de censure. La responsabilité politique postule donc l’impossibilité pour le gouvernement de demeurer au pouvoir s’il ne dispose pas de la confiance de la majorité. Elle est donc l’occasion d’affrontement entre l’exécutif et le législatif, un système de vigilance entre le parlement et le gouvernement .
B – La consécration des contre-pouvoirs
Le régime présidentialiste mis en place au lendemain des indépendances tendait à asseoir l’autorité du président de la République. Cette omnipotence présidentielle ne pouvait rayonner que dans un cadre de la monopolisation du centre d’impulsion politique. L’avènement du parti unique parachevait la construction, dans les pays ayant choisi ce système, des autoritarismes. L’enjeu des réformes politiques des années 1990 est donc de libérer les forces politiques et sociales en traduisant au plan juridique l’Etat de droit. Or il n’y a de pouvoir qui tienne que parce qu’il y a des contre-pouvoirs. La démocratie suppose le refus de la majorité dans le respect de la minorité. Le constituant camerounais a pensé à un système qui garantissait à la fois l’exercice de l’autorité de l’Etat et les limites de cette autorité. Trois catégories de contre-pouvoirs ont été envisagées : des contre-pouvoirs politiques et administratifs d’une part et les contre-pouvoirs juridictionnels d’autre part.
1- les contre-pouvoirs non juridictionnels
Il s’agit essentiellement de l’institution du Sénat, contre-pouvoir politique par excellence et l’adoption d’un mécanisme de régulation au sein de l’administration.
En ce qui concerne le Sénat, il faut souligner que, bien qu’il constitue une des deux chambres du parlement, illustration du bicamérisme, le Sénat est essentiellement un contre-pouvoir politique face à une Assemblée nationale très souvent de connivence avec le gouvernement. Le Sénat, de part sa situation particulière, sert d’équilibre et parfois de contre-poids important dans l’orientation de l’action politique de l’Etat. Son rôle n’est pas uniquement de représenter les collectivités territoriales et des corporations infra étatiques, il va au-delà pour influer sur la décision politique. La difficulté majeure réside dans le fait qu’à ce jour, sa mise en place est attendue..
En ce qui concerne la gestion des secteurs socioéconomiques, l’Etat intervient par des organismes spécifiques, il s’agit des agences de régulation qui sans lui faire perdre ses prérogatives, permettent à celui-ci d’atteindre de manière optimale ses objectifs. Dans le cadre de cette politique de réputation, l’Etat a entrepris ce mode de gestion dès 1990 à la faveur de la loi relative à la liberté de communication sociale. Le législateur a, pour la première fois, créé le Conseil national de la communication.
A ce jour, on note une floraison d’agences de régulation au niveau des secteurs comme les télécommunications (loi n°98/014 du 14 juillet 1998), le secteur portuaire (loi n°98 /024 du 24 décembre 1998), l’électricité (loi n°98/022 du 24 décembre 1998), l’aviation civile (loi n°98/023 du 24 décembre 1998).
Ces organismes qui ont des équivalents en droit comparé constituent des techniques nouvelles de gestion efficace de l’activité administrative. Disposant d’un pouvoir normatif et de contrôle large, les agences de régulation doivent garantir l’objectivité et l’égalité dans l’action administrative car leur action, reconnaît-on, est censée être soustraite aux influences politiques et des intérêt corporatistes ou individualistes .
2- Les contre-pouvoirs juridictionnels
Au plan juridictionnel, on a assisté à l’érection de l’autorité judiciaire en pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est restructuré. Aux termes de la constitution de 1996, ce pouvoir est dirigé par une Cour Suprême. Celle-ci dispose de trois principales formations : une chambre administrative, une chambre judiciaire et une chambre des comptes.
L’avènement d’une chambre des comptes pourrait constituer une garantie de sécurité de la fonction publique. Le chantier des réformes reste entier puisque les tribunaux inférieurs n’ont pas encore été créés, de même que les tribunaux administratifs prévus par la constitution.
L’autre reforme prévue dans la constitution est l’institution d’un Conseil constitutionnel. Jusqu’en 1996, la juridiction constitutionnelle prévue pour statuer conformément aux anciennes dispositions 7, 10 et 27, organisée par l’article 33 de la Constitution devait chaque année être mise en place par le président de la République. Composé des magistrats et des personnalités désignées par le président de la République, cette instance ne s’est jamais réunie.
La création d’un juge spécifique protecteur de l ‘autorité et de la liberté, bref garant de l’état de droit, s’inscrit dans une dynamique de consécration d’un ordre juridique autour de la constitution, de garantie des droits et libertés individuels et de protection de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel s’est déjà illustré en sanctionnant pour inconstitutionnalité, la loi portant Règlement de l’Assemblée nationale.
Dans sa décision du 28 novembre 2002, le juge a estimé que la Représentation nationale ne saurait méconnaître ses obligations en vertu de la Constitution. Il s’agit là d’un rappel clair pour le respect de l’état de droit. La procédure de validation des mandats reconduite par les députés au nom d’une souveraineté imaginaire est contraire à la constitution. La promulgation de cette loi par le président de la République devrait être considérée comme promulgation sous réserve. La loi n’est expression de la volonté générale que dans le respect de la constitution. Les députés l’ont certainement compris.
II – La modernisation des structures verticales du pouvoir
L’organisation verticale du pouvoir d’Etat a connu d’importants changements. Certes, le Cameroun est un Etat unitaire c’est à dire, qu’il ne connaît qu’une seule autorité juridique et politique disposant de l’ensemble de ses compétences sur son territoire régi par un seul et unique droit. On a parlé ici d’un seul ordre juridique à l’exclusion de tout autre.
Si la forme de l’Etat n’a pas changé malgré la revendication du retour à la forme fédérale, l’Etat unitaire, forme achevée de l’Etat a subi d’intéressants bouleversements notamment avec l’avènement de la décentralisation. Ce changement conduit à élargir l’expression politique et donc, à démultiplier les cadres d’expression de l’assentiment.
A- La réforme des relations Centre-Périphérie
La réforme constitutionnelle de 1996 fait du Cameroun un Etat unitaire décentralisé. Il est intéressant de rappeler l’esprit de la Constitution d’une part, et de déterminer les interventions de l’Etat d’autre part.
1- L’élargissement de l’administration locale
La décentralisation connaît deux niveaux au Cameroun depuis la réforme constitutionnelle de 1996 : la commune et la région. La province actuelle est érigée en collectivité territoriale à part entière, disposant à sa tête d’un exécutif élu. Le Conseil régional, sorte d’assemblée locale est dirigé par un président élu. Seule fausse note, l’obligation faite par la constitution de désigner un autochtone. Avec la commune, la région va bénéficier du principe de la libre administration des collectivités locales. Cette libre administration doit s’effectuer dans le respect de la constitution et des lois de la République. La lecture de la Constitution amène à penser que ces collectivités ne détiennent aucun pouvoir législatif et reçoivent des compétences dévolues au domaine de la loi par la constitution .
Les lois de la décentralisation n’ont pas encore été adoptées. Les collectivités sont représentées par le Sénat au niveau du pouvoir central. Afin d’éviter toute confusion dans les esprits, la décentralisation n’est pas synonyme de fédération. La décentralisation consiste dans le transfert de compétences du pouvoir central à d’autres autorités dotées de la personnalité morale, gérant elles-mêmes leurs affaires au moyen d’organes propres. Les autorités restent soumises au contrôle de l’Etat. La question qui se pose habituellement est celle liée à la garantie de l’unité et de l’individualité de l’Etat. Puisque le Cameroun est une République une et indivisible.
L’indivisibilité de la République peut revêtir trois aspects : indivisibilité de la souveraineté confirmée par une autre disposition de la Constitution ; indivisibilité du territoire, le conflit de Bakassi en est une illustration, indivisibilité du peuple, le peuple camerounais étant composé de tous les concitoyens sans distinction d’origine, de race, ou de religion. Si la constitution garantit la diversité culturelle et l’expression des identités, elle protège la nation camerounaise conçue de manière subjective comme produit de l’histoire dans la lignée de Fustel de Coulanges ou d’Ernest Renan.
2- La survivance du contrôle de l’Etat
Jusqu’en 1996, le Cameroun est demeuré un Etat centralisé Cette tentation à la centralisation perdure depuis lors, puisque les lois de la décentralisation ne sont pas encore adoptées par le parlement. En l’absence d’une loi sur la décentralisation, il est difficile de déterminer les conditions d’exercice du contrôle sur les actes des autorités locales. La présence d’un délégué de l’Etat dans chaque région rappelle le droit de regard de l’Etat sur l’administration locale. Si l’on peut se permettre une réflexion de lege feranda, il est souhaitable que l’on supprime la tutelle classique. On opterait pour des contrôles a posteriori de régularité et non plus d’opportunité. Les contrôles devant désormais être juridictionnalisés en faisant intervenir à la fois les tribunaux administratifs et les tribunaux des comptes.
Cela allégerait la tutelle technique exercée par l’autorité administrative. Celle-ci restant le maillon essentiel dans le dialogue nécessaire entre l’administration d’Etat et les collectivités territoriales. D’abord, l’Etat pourrait conserver le contrôle administratif. Ce contrôle devant distinguer les actes de gestion courante qui seraient applicables immédiatement et les actes plus importants notamment ceux résultant des délibérations qui devront avoir l’aval de l’autorité administrative. Le représentant de l’Etat pouvant déférer au juge administratif les actes qu’il estime irréguliers.
En de recours, les actes incriminés ne peuvent être mis en exécution (sursis à exécution) jusqu’à la décision définitive du juge administratif.
A côté des contrôles administratifs, on peut imaginer les contrôles budgétaires. Ces contrôles font intervenir le juge. La Chambre régionale des comptes pouvant donc jouer le double rôle de contrôleur financier a posteriori et de juge des comptes. On pourrait donc assister à l’exercice d’un pouvoir de substitution en cas de constatation d’une quelconque irrégularité sur le plan du budget. Evidemment tout ceci n’est que supputation, les lois de la décentralisation restant incertaines au moins avant l’échéance présidentielle de 2004. En imaginant que le vote de ces textes intervienne à session de la novembre 2003 ou de mars 2004, il est difficile d’envisager la mise en place des régions avant l’échéance présidentielle.
A la réalité, on risque également d’assister au maintien du régime actuel de tutelle tel qu’il s’applique aux communes. Cette tutelle est dangereuse et peut bloquer le fonctionnement des régions et créer une instabilité politique aux conséquences inimaginables. Une réforme en profondeur s’impose donc pour asseoir une démocratie participative.
B- L’amélioration de l’expression politique
La modernisation de l’Etat s’est traduite également par l’élargissement de l’expression de la démocratie d’une part et la recherche accrue d’une nouvelle légitimité.
1 – La démultiplication des cadres d’expression de l’assentiment
Le bicamérisme a introduit une nouvelle chambre au parlement dont la particularité est la représentation des collectivités territoriales. Cette mutation institutionnelle élargit ainsi les cadres d’expression de la volonté populaire.
Au plan national, la vie politique est rythmée par les consultations électorales tendant à la désignation des autorités dans l’Etat. L’élection est devenue la voie royale vers l’exercice du pouvoir dans l’Etat. Elle rejoint le référendum qui permettait même en période de parti unique de consulter les populations sur un texte. Lorsqu’on parle d’élections, on évoque le cycle politique constitué par le mandat. L’élection à la présidence de la République se tient donc touts les 7 ans au suffrage universel direct. Avant la révision du 18 janvier 1996, la durée du mandat du président de la République était de 5 ans renouvelable
Le choix d’un septennat renouvelable une seule fois est le résultat d’un compromis entre le chef de l’Exécutif et les députés à l’Assemblée nationale. Ces derniers voulaient limiter le nombre de mandats. Devant le refus du président de la République, ils ont finalement concédé l’élargissement à 7 ans mais renouvelable une seule fois.
Toujours au plan national, les élections des députés aux termes d’un mandat de 5 ans sauf sabordage ou dissolution prématurée, vont se tenir concomitamment avec le scrutin pour la désignation des sénateurs. Sur 100 sénateurs, 70 seront au suffrage indirect tandis que 30 sont nommés par le président de la République.
Au plan local, les citoyens disposent d’un autre cadre d’expression de leur volonté : c’est à l’occasion de l’élection des conseillers généraux qui, associés aux conseillés municipaux, constituent des élus locaux. Ces consultations multipliant les procédés démocratiques, la participation à la vie publique, elles constituent plus que tout autres, une chance d’asseoir une légitimité durable et de construire des pouvoirs de progrès.
.
2- Vers une novelle légitimité
La démocratie camerounaise souffre d’un manque de légitimité. L’obéissance au droit suppose la légitimité des pouvoirs qui s’exercent dans l’Etat. Le droit doit devenir la réponse au besoin de sécurité, de solidarité. Les faiseurs de droit doivent avoir la caution politique des populations. Les réformes dans ce sens devront toucher le mode de scrutin du président de la République, le mode de désignation des sénateurs. La nomination de trente sénateurs par le chef de l’Etat porte atteinte au sacrosaint principe de la séparation des pouvoirs. De la même manière, une sorte de calendrier doit permettre au pouvoir de conduire dans les délais raisonnables les réformes exigées par le constituant.
Cette progressivité discriminatoire trahit les impératifs d’une gouvernance partagée portée au service de la collectivité. La démocratie suppose l’écoute et la traduction sous forme de normes des aspirations des populations. Le droit désiré doit remplacer le droit imposé.
Aux grands hommes la patrie reconnaissante signifie aussi que chacun apporte à l’édifice des fruits de son génie propre. Chacun pourrait donc affirmer ceci : je n’ai pas créé la République, j’ai tout simplement donné à la République les fondations qu’elle n’avait jamais eues. C’est de cette manière que l’on construira la Nation camerounaise, un peu comme nos Lions Indomptables qui nous rappellent que nous avons un destin commun. Réconcilier l’autorité et la liberté, c’est construire des solidarités agissantes et penser à l’intérêt général avant les intérêts particuliers.
Marcelin Nguélé Abada est
Chargé de cours à l’Université
De Yaoundé 2 (Soa)