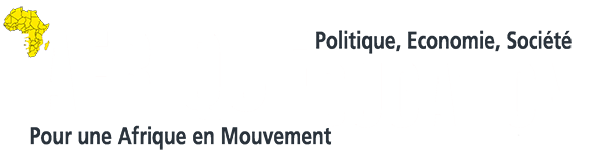X
SOUDAN : DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE CIVIL ABDALLAH HAMDOK (SUR FOND DE DÉCEPTION DU PEUPLE)

Date
Le premier ministre civil soudanais, Abdallah Hamdok, a annoncé, dimanche, 2 janvier, sa démission, après une nouvelle journée de manifestation durant laquelle deux personnes ont été tuées. Il était revenu au pouvoir, il y a moins de deux mois, dans le cadre d’un accord politique conclu avec les militaires. Cette démission certes attendue, voire, même suscitée, restera une grande déception des partisans de l’ex-premier ministre au sein de la société civile soudanaise. Cela montre que les militaires ont réussi à récupérer presque la totalité du pouvoir et que leur ancien patron et ancien président, Omar el-Béchir, que Hamdok et ses amis voulaient envoyer à la CPI (Cour pénale internationale) avec le soutien actif des Occidentaux (ce qui constituait une erreur monumentale), va rester au Soudan où il est actuellement jugé.
Alors que la rumeur ne cessait d’enfler et que la presse locale assurait qu’il ne se présentait plus à son bureau depuis des jours, Abdallah Hamdok (notre photo) a jeté l’éponge, expliquant, longuement, sur la télévision d’Etat avoir tout tenté mais avoir finalement échoué dans un pays dont la « survie » est, selon lui, « menacée » aujourd’hui.
« J’ai tenté de mon mieux d’empêcher le pays de glisser vers la catastrophe, alors qu’aujourd’hui, il traverse un tournant dangereux qui menace sa survie (…) au vu de la fragmentation des forces politiques et des conflits entre les composantes (civile et militaire) de la transition (…). Malgré tout ce qui a été fait pour parvenir à un consensus (…), cela ne s’est pas produit », a-t-il notamment argué. Il a ajouté qu’une réunion était nécessaire pour parvenir à un nouvel accord pour la transition politique du pays.
Les différentes forces politiques du pays sorti en 2019 de 30 années de dictature militaro-islamiste d’Omar el-Béchir sont trop « fragmentées », a-t-il dit, et les camps civil et militaire trop irréconciliables pour qu’un « consensus » vienne « mettre fin à l’effusion de sang » et donner aux Soudanais le slogan phare de la révolution anti-Béchir de 2019 : « liberté, paix et justice ».
Cet ancien économiste onusien, qui avait obtenu l’effacement de la dette du Soudan et sa sortie du ban mondial, n’a pas connu un moment de répit depuis le coup d’état du 25 octobre.
Ce jour-là, son principal partenaire, le chef de l’armée, le général, Abdel Fattah al-Burhane, l’a fait placer en résidence surveillée au petit matin. Et avec lui, la quasi-totalité des civils des autorités de transition, rompant brutalement l’attelage baroque de 2019.
Alors, la pression populaire forçait l’armée à démettre l’un des siens, Omar el-Béchir. Généraux et civils s’entendaient sur un calendrier de transition, qui prévoyait une remise du pouvoir tout entier aux civils avant des élections libres en 2023.
Mais, le 25 octobre, le général Burhane a rebattu les cartes : il a prolongé de deux ans son mandat de fait à la tête du pays et réinstallé, un mois plus tard, Abdallah Hamdok, tout en ayant préalablement remplacé bon nombre de responsables – notamment au sein du Conseil de souveraineté qu’il chapeaute -, en extrayant les partisans les plus actifs d’un pouvoir civil.
Aussitôt, Abdallah Hamdok est devenu l’ennemi de la rue, le « traître », qui aidait les militaires à « faciliter le retour de l’ancien régime ».
Les manifestants, qui depuis le 25 octobre, conspuent le général Burhane dans la rue, se sont mis à le conspuer, lui aussi.
Car dans un pays presque toujours sous la férule de l’armée depuis son indépendance il y a 65 ans, les manifestants le clament : ils ne veulent « ni partenariat, ni négociation » avec l’armée.

Et ils le redisent de plus en plus souvent au risque de leur vie : dimanche, 2 janvier, de nouveau, parmi les milliers de Soudanais sortis dans les rues, trois ont été tués par des balles ou des coups de bâton des forces de sécurité, rapporte un syndicat de médecins pro-démocratie. Des « morts de la démocratie » que l’Occident, principal soutien des civils, n’aidera, jamais, à venger. A quoi bon d’aller au casse-pipe quand on connait d’avance le résultat ? Les militaires sont soutenus par des puissants alliés de la région, notamment, les monarchies du Golfe, surtout, l’Egypte voisin. Ces derniers n’ont guère toléré l’empressement du nouveau pouvoir de Hamdok à nouer des relations diplomatiques avec Israël à la demande de Donald Trump, alors chef de la Maison Blanche. Une telle reconnaissance précipitée était considérée comme une haute trahison dans les pays arabes. Le coup de grâce, c’était d’annoncer la traduction du général, Omar el-Béchir, à la Cour pénale internationale, suprême humiliation pour non seulement le Soudan, mais aussi, l’Afrique en général. Béchir n’y sera, sans doute, plus jugé, ce qui sauve la face de beaucoup de gens au Soudan et en Afrique. Mais, le combat n’est pas encore terminé. L’Occident, sur ce plan, n’a pas encore abdiqué.
En tout, depuis le 25 octobre, 57 manifestants ont été tués et des centaines blessés.
Un conseiller du général Burhane a jugé vendredi que « les manifestations ne sont qu’une perte d’énergie et de temps » qui ne mènera « à aucune solution politique ».

Les Européens ont déjà exprimé leur indignation, de même que le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, et les Nations-Unies. Tous plaident pour un retour au dialogue comme préalable à la reprise de l’aide internationale coupée après le putsch dans ce pays, l’un des plus pauvres au monde.
Antony Blinken a prévenu samedi, 1er janvier, que les Etats-Unis étaient « prêts pour répondre à tous ceux qui cherchent à empêcher les Soudanais de poursuivre leur quête d’un gouvernement civil et démocratique ». La menace de Blinken n’est qu’une énième intervention d’une Amérique impérialiste qui refuse que le Soudan prenne en main son destin. Heureusement que, jusqu’à ce jour, la volonté néfaste de Oncle Sam n’arrive pas à se traduire dans les faits. Les Etats-Unis, on le voit dans ce conflit inter-soudanais et dans plusieurs autres, ne sont plus qu’un géant aux pieds d’argile. Autrement dit, Washington sait aboyer mais ne sait plus mordre. Les Américains ne font plus peur à personne au Soudan.